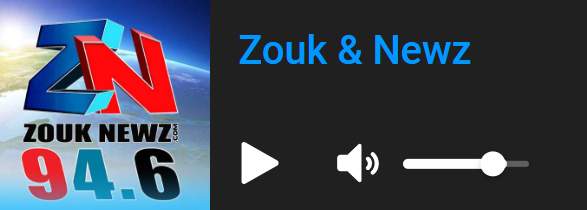Par James B. Foley

L’assassinat choquant du président haïtien, Jovenel Moïse, soulève des questions urgentes sur l’avenir du pays et a de graves implications pour les États-Unis. Alors qu’Haïti s’enfonce de plus en plus dans le chaos, nous devons avoir une compréhension réaliste de sa longue histoire de troubles politiques, pour mieux saisir la situation dans laquelle il se trouve.
De toutes les choses avec lesquelles nous devons lutter, aucune n’est plus importante que celle-ci : les options auxquelles sont confrontés Washington et la communauté internationale lorsqu’il s’agit d’aider à apporter la stabilité et un certain développement à Haïti sont peu prometteuses ou désagréables. Nous devons donc nous concentrer sur ce qui est réellement réalisable face aux réalités haïtiennes et aux capacités limitées des États-Unis.
Il ne fait aucun doute que les puissances étrangères portent la responsabilité des causes profondes de bon nombre des maux contemporains d’Haïti : de l’histoire brutale du pays en tant que colonie d’esclaves de la France, à son imposition par la France d’une indemnité écrasante et à son traitement par les États-Unis pendant une grande partie du 19e siècle. Dans de telles circonstances, il n’est pas étonnant qu’Haïti n’ait pas réussi à développer des institutions gouvernementales fonctionnelles et l’état de droit.
L’autre conséquence du passé tragique d’Haïti a été une lutte incessante pour le pouvoir dans un déficit chronique de légitimité politique. Le cycle s’est répété tout au long de l’histoire haïtienne : les dirigeants montent et descendent, beaucoup rencontrant une fin violente. Ils gouvernent arbitrairement et parfois tyranniquement, considérant leurs adversaires comme des séditieux. Les forces d’opposition se méfient des dirigeants et se tournent souvent vers la rébellion. Personne n’accepte la légitimité de l’autre. La politique est à somme nulle.
« Aussi mauvaise que puisse être la situation à un moment donné, elle est invariablement sur la voie de quelque chose de pire. »
Depuis les années 1950, Haïti a été pris dans un vortex descendant, avec la pauvreté, la surpopulation, la dévastation de l’environnement et l’anarchie dépassant progressivement les capacités de l’État de décennie en décennie. Aussi mauvaise que puisse être la situation à un moment donné, elle est invariablement sur la voie de quelque chose de pire. Ce qui nous amène au présent, avec des gangs criminels armés terrorisant la population, et des acteurs et institutions politiques désormais complètement dépourvus d’autorité — le président assassiné, son successeur constitutionnel récemment décédé, le corps législatif disparu et les premiers ministres par intérim successifs au statut incertain.
Les États-Unis sont intervenus à plusieurs reprises en Haïti au cours du siècle dernier, à partir de 1915 avec une occupation du pays de près de 20 ans par les Marines américains – mais cette implication, même avec des efforts bien intentionnés et fortement financés, a été problématique et n’a accompli que peu de résultats avec un bénéfice durable.
Mon expérience en tant qu’ambassadeur des États-Unis en Haïti reflétait ce schéma. Je suis arrivé à Port-au-Prince en septembre 2003, alors que Jean-Bertrand Aristide était à mi-chemin d’un second mandat ardu à la présidence. L’opposition politique refusa d’accepter sa légitimité et exigea sa démission ; il a également été rejeté par un large éventail de groupes de la société civile aliénés par les tactiques violentes de ses partisans. Le président lui-même, bien que toujours un champion symbolique des masses appauvries d’Haïti, était de toute évidence revenu d’exil une décennie auparavant cynique à l’idée de gouverner mais déterminé à survivre selon les règles traditionnelles de la politique haïtienne. Il a rapidement fait une coquille de la Police nationale haïtienne, que les États-Unis avaient contribué à professionnaliser à grands frais, en mettant aux commandes des loyalistes voyous et en remplissant ses rangs d’anciens membres de gangs. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, il s’est tourné vers les gangs de rue criminels pour se muscler politiquement, ce qui est finalement devenu le pilier de son régime. Selon la Drug Enforcement Administration des États-Unis, le gouvernement haïtien était également complice au plus haut niveau avec les narcotrafiquants.
« Avant mon arrivée, l’attente parmi l’opposition et l’élite haïtienne était que l’administration Bush agirait bientôt unilatéralement pour réaliser son rêve d’évincer Aristide. »
Pendant que j’étais en Haïti, Aristide a résisté à des réformes significatives, craignant sans aucun doute que la rupture des liens avec les gangs et la réduction de la violence politique ne mettent en péril son emprise sur le pouvoir. Lors de nos réunions, il insérait invariablement une étrange référence à la Floride d’une manière censée suggérer sa capacité à provoquer une crise migratoire, un avertissement clair aux États-Unis pour qu’ils reculent. L’opposition, quant à elle, était tout aussi intransigeante. Lors de dizaines de réunions avec des personnalités politiques du gouvernement et de l’opposition, pas une seule fois je n’ai entendu l’un d’entre eux soulever ou souhaiter discuter de l’un des problèmes majeurs d’Haïti. Peut-être l’hypothèse était-elle que rien ne pouvait être fait ; l’accent a toujours été et uniquement mis sur la lutte pour le pouvoir.
Avant mon arrivée, l’attente parmi l’opposition et l’élite haïtienne était que l’administration Bush agirait bientôt unilatéralement pour réaliser son rêve d’évincer Aristide. Et c’est ce qui s’est réellement passé à ce jour, selon Aristide et ses partisans. Cependant, je peux dire catégoriquement qu’il n’y avait aucun soutien à Washington à l’époque pour une quelconque intervention ou implication en Haïti. Mes instructions étaient avant tout de prévenir toute crise qui pourrait déclencher une migration de masse.
Face à la réalité selon laquelle les États-Unis n’interviendraient pas, des éléments de l’opposition et du monde des affaires ont apparemment décidé de prendre les choses en main en s’associant à d’anciens militaires haïtiens en exil pour lancer une rébellion armée, qui a commencé en février 2004. Alors qu’ils approchaient de Port-au-Prince et que le chaos montait dans la capitale, je visais à dissuader Aristide de déchaîner ses partisans pour commettre des violences de masse. En même temps, j’ai cherché à manœuvrer pour empêcher les forces rebelles et leurs soutiens invisibles de prendre le pouvoir et de déclencher leur propre bain de sang. Aristide a alors déployé son arme ultime : faire semblant d’encourager les Haïtiens à fuir le pays, déclenchant un exode de bateaux à grande échelle qui a instantanément concentré les esprits à Washington. Lorsque ce pari a été bloqué par l’interdiction brutale des bateaux de migrants par les navires de la Garde côtière américaine, Aristide a demandé aux États-Unis d’organiser son départ en toute sécurité (qu’il a appelé plus tard un enlèvement). En quelques heures, les premiers membres d’une force de stabilisation internationale dirigée par les « marines » américains sont arrivés, faisant battre en retraite les rebelles et les empêchant de prendre le pouvoir.
Nos espoirs initiaux qu’une période de paix et de stabilité offerte par une importante présence internationale de sécurité donnerait à Haïti un répit pour commencer à faire face à ses nombreux défis n’ont pas survécu au retrait rapide de la force dirigée par les États-Unis quatre mois plus tard. Bien que la mission de maintien de la paix des Nations Unies qui a suivi n’ait pas pu empêcher une résurgence de la violence, elle a fourni suffisamment de soutien à la Police nationale haïtienne pour tenir à distance l’anarchie pure et simple. La décision de l’ONU de mettre fin complètement à cette mission en 2019 était donc lourde de risques, comme on le voit aujourd’hui.
La situation actuelle a des similitudes avec celle à laquelle j’ai été confrontée en 2004, mais à certains égards, elle est pire. A l’époque comme aujourd’hui, il n’y avait pas de consensus sur la légitimité politique, et la violence s’en est suivie. Mais en 2004, un président en exercice de la Cour suprême haïtienne, après la démission d’Aristide, a assumé la présidence légalement, conformément à la constitution haïtienne. Aujourd’hui, le pays souffre d’un vide d’autorité légale.
Haïti est à nouveau au bord du gouffre, confrontant Washington à une décision d’envoyer ou non des troupes, comme l’avait demandé le précédent Premier ministre par intérim. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le déploiement rapide des forces américaines en 2004 a tué l’anarchie dans l’œuf et peut-être sauvé des dizaines de milliers de vies. Sans cette intervention, l’économie aurait été détruite, les institutions étatiques décimées et une migration de masse soutenue aurait été déclenchée.
« Si la situation en Haïti continue de se dégrader, le déploiement temporaire des forces américaines peut devenir nécessaire. »
Dans les circonstances actuelles, je vois deux options de base auxquelles l’administration Biden est confrontée, ainsi qu’un scénario potentiellement pessimiste.
La première option serait une intervention internationale majeure, dirigée par les États-Unis, visant à fournir à Haïti la sécurité et l’assistance à long terme dont il a besoin pour construire un État moderne et faire face à ses nombreuses difficultés. Mettre Haïti sur une trajectoire différente nécessiterait un déploiement illimité de personnel et de ressources internationaux, un engagement qui – en 1994, 2004 et 2010 – s’est déjà avéré insoutenable et, à bien des égards, contre-productif. Cette option mérite d’être considérée car elle rend compte de l’ampleur réelle du dysfonctionnement systémique d’Haïti, mais elle est probablement au-delà des moyens des États-Unis ou de leurs partenaires internationaux.
La deuxième option serait de prendre du recul et de permettre aux Haïtiens de déterminer une voie à suivre pour leur pays. D’après les articles de presse, c’est quelque chose que privilégient de nombreux Haïtiens qui considèrent que les interventions internationales précédentes n’ont pas servi les intérêts d’Haïti ou n’ont profité qu’aux élites locales. Une stratégie de non-intervention pourrait en principe permettre à Haïti de trouver son propre équilibre, mais une telle approche repose sur la thèse selon laquelle les efforts internationaux ont été la principale cause ou contributeur au dysfonctionnement d’Haïti, plutôt que des facteurs internes. Des milliers de personnes pourraient périr avant qu’un « équilibre » ne soit atteint, et il est loin d’être certain que les Haïtiens sortiraient de la tourmente sur la voie des élections et de la gouvernance fonctionnelle.
La deuxième option reflète le fait que les États-Unis ont déjà d’énormes défis et responsabilités mondiaux et ne peuvent pas tous les relever. C’est franchement du même ordre que les décisions que les États-Unis ont prises de retirer leurs troupes d’Afghanistan et de raviver un accord nucléaire imparfait avec l’Iran. Le président Joe Biden est confronté à des choix douloureux mais nécessaires en matière de politique étrangère pour renforcer la dissuasion américaine contre une éventuelle agression russe en Europe et chinoise en Asie.
Washington semble donc obligé d’adopter une version de cette dernière option, qui a l’avantage de permettre aux Haïtiens de prendre en main leur propre destin, fondamental pour tout espoir de changement significatif. Mais les chances de succès d’un gouvernement haïtien qui émergera des élections dépendront toujours de la volonté des États-Unis et de leurs partenaires d’investir les ressources nécessaires pour mettre en place des institutions étatiques et répondre aux besoins énormes d’Haïti. Washington doit également être prêt à soutenir le redéploiement d’une présence sécuritaire de l’ONU, si cela s’avère indispensable à la tenue d’élections réussies et à la viabilité d’un nouveau gouvernement.
Dans le même temps, l’administration Biden serait prudente pour accélérer tranquillement la planification d’une autre éventualité. Si la situation en Haïti continue de se dégrader, le déploiement temporaire des forces américaines peut devenir nécessaire pour arrêter le glissement vers l’anarchie. Alors qu’une intervention dirigée par l’ONU serait préférable, Washington doit être prêt à agir rapidement et unilatéralement en cas d’effondrement complet de ce qui reste de l’autorité de l’État haïtien.
En raison de sa proximité géographique autant que de son dysfonctionnement unique, Haïti a le moyen de s’imposer au sommet de l’agenda de sécurité nationale des États-Unis. Si le chaos endémique se transformait en anarchie complète, envoyant des Haïtiens en grand nombre sur des bateaux branlants en direction de la Floride, la pression sur Washington pour faire quelque chose deviendrait irrésistible. Un siècle de preuves à cet effet a conduit le commandant des Marines américains quittant Haïti en 2004 à conseiller à ses officiers : « Ne jetez pas vos cartes. Nous reviendrons certainement. »
À propos de l’auteur : James B. Foley est un ancien diplomate américain. Il a été ambassadeur en Haïti de 2003 à 2005, et en Croatie de 2009 à 2012.
Sources : Le Nouvelliste et The Atlantic
Lien : https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/07/america-haiti-limited-options/619481/
(Traduit de l’anglais par Patrick SAINT-PRE)