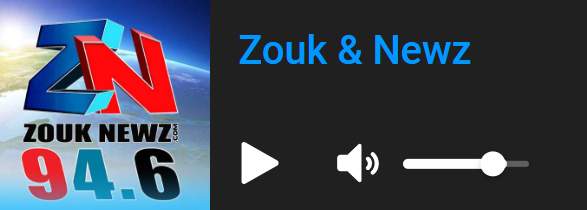PAR JEAN-MARIE NOL*
A travers les exemples concrets tirés de l’histoire, nous réitérons notre thèse précédemment développée que les dysfonctionnements économiques se situent au cœur des maux politiques, sociétaux, sociaux, institutionnels, idéologiques et identitaires qui affectent une société.
En effet, force est de constater que les émeutes, pillages et destructions d’entreprises observés en Nouvelle-Calédonie et en Martinique s’inscrivent dans des dynamiques économiques complexes, mêlant des enjeux idéologiques, sociaux, historiques et psychologiques. Ces exactions ciblant principalement les entreprises traduisent un mal-être profond et révèlent les tensions accumulées au sein de ces sociétés au fil de l’histoire Mais cela étant dit, il convient de relever le paradoxe de l’attitude des élus de Nouvelle-Calédonie qui réclament aujourd’hui à l’État français une somme de 5,3 milliards d’euros pour la reconstruction, et signaler aussi le parallélisme avec les élus locaux de la Martinique notamment en la personne du président serge Letchimy qui a demandé au premier ministre Michel Barnier une subvention de 100 millions d’euros pour la reconstruction de la Martinique.
Ces demandes qui ont peu de chances d’aboutir vu la dégradation accélérée des finances publiques de la France révèlent tout de même une prédominance incontournable de l’économie sur le politique. Nous en voulons pour preuve l’exemple de Haïti à travers l’histoire depuis l’époque de la révolution des esclaves jusqu’à nos jours. Présentement, La situation en Haïti est aujourd’hui un véritable casse-tête pour la communauté internationale.
Le pays souffre d’une terrible misère et est plongé dans un chaos sécuritaire sans précédent, largement dominé par des gangs armés qui contrôlent une grande partie de la capitale, Port-au-Prince, et son environnement. Alors que la Mission multinationale d’appui à la sécurité en Haïti (MMAS) a été déployée pour lutter contre cette menace, elle est actuellement en échec tout comme hier.
En Haïti et aux Antilles françaises comme en France et dans le monde, ce sont les enjeux économiques et climatiques qui domineront, davantage que le politique avec le retour des crises économiques et financières voire subséquemment du retour du protectionnisme.
Et c’est dans ce cadre d’un nouveau paradigme de la crise de la dette que toute tentative politique de rattrapage du mal développement de la Martinique et de la Guadeloupe par le statut d’autonomie , va nécessairement impliquer un coût financier pour la collectivité. Il est donc nécessaire que les pouvoirs publics nationaux et locaux l’explicitent à la population des Antilles.
Nous surestimons les probabilités de vivre des évènements heureux au cours de la vie et sous-évaluons les probabilités d’en vivre de mauvais. C’est à la fois avantageux et dangereux, puisque ce biais nous conduit à moins évaluer les risques politiques et économiques d’une situation de crise
En effet de façon paradoxale , les politiques locaux vont brandir l’étendard du changement de statut comme étant la panacée de nature à résoudre tous les problèmes de la Martinique et la Guadeloupe, notamment le mal être identitaire et le mal développement économique. C’est là une chimère !
A ceux qui penseraient que l’on suscite la peur du changement de statut, et qu’il n’est rien de nouveau sous le soleil, il est conseillé de se replonger dans l’histoire de la première République noire, Haïti, pour comprendre comment l’économie peut supplanter la politique et la finance à travers le secteur bancaire jouer un rôle néfaste déterminant dans la vie d’un pays.
L’indépendance est proclamée en Haïti en 1804. Mais le conflit avec la France n’est soldé qu’en 1825, quand le roi Charles X accepte de reconnaître Haïti contre une importante somme d’argent. Donc, bien que Haïti fut la première nation moderne à obtenir son indépendance grâce à une révolte d’esclaves, son développement économique a été sans cesse entravée financièrement sur plusieurs générations par les réparations exigées au bénéfice des anciens colons français. En déclarant son indépendance le 1er janvier 1804, Haïti s’est donc retrouvé au ban des nations d’un monde alors dominé par les puissances esclavagistes.
La destruction des domaines agricoles par les esclaves et les paiements exigés par la France ont autant privé l’économie haïtienne de ressources vitales à son essor qu’ils ont permis à son ancienne métropole de prospérer.
Cette histoire, c’est celle de « la rançon de l’indépendance » — expression utilisée par François Hollande en 2015 — payée par Haïti à la France de 1825 au début des années 1950 pour indemniser les propriétaires esclavagistes ; et l’implication, jusqu’à présent méconnue, du Crédit industriel et commercial (CIC), aujourd’hui filiale du Crédit mutuel. Plusieurs articles parus dans le New York Times ont retracé comment le C.I.C. a créé et géré la Banque nationale d’Haïti à partir de Paris. Les dossiers découverts par les enquêteurs montrent qu’elle n’a fait aucun investissement dans les entreprises haïtiennes et a facturé des frais sur presque toutes les transactions effectuées par le gouvernement haïtien.
La Banque Nationale d’Haïti, sur laquelle tant d’espoirs étaient fondés , n’avait en fait de nationale que le nom. Loin d’être la clé du salut du pays, la banque a été, dès sa création, un instrument aux mains de financiers français et un moyen de garder une mainmise asphyxiante sur l’ancienne colonie jusqu’au 20e siècle.
Derrière cette banque nationale fantoche, on retrouve un nom bien connu des Français : le Crédit Industriel et Commercial (CIC).
Alors qu’à Paris, le CIC participe au financement de la tour Eiffel, symbole de l’universalisme français, il étouffe au même moment l’économie haïtienne en rapatriant en France une grande parties des revenus publics du pays, au lieu de les investir dans la construction d’écoles, d’hôpitaux et autres institutions essentielles à toute nation indépendante.
À un moment donné, Haïti a affecté environ la moitié de sa source de revenus la plus importante – les taxes sur le café et le sucre – au paiement du C.I.C. et ses investisseurs dans la Banque Nationale.
En 1875, Haïti a déjà réglé une grande partie de sa « dette », dont le poids a parfois dépassé 40 % de ses recettes annuelles. Elle a plongé sa population dans la misère , un mot sur toutes les lèvres quand on évoque le pays le plus pauvre de l’hémisphère Nord. Cette série d’articles du New York Times publiés récemment remet en lumière la tragique histoire de l’indépendance d’Haïti. Comme l’Etat français, la banque a sciemment privé la première république noire de l’histoire des moyens d’investir dans l’éducation, la santé et les infrastructures porteuses de développement, et de s’insérer ainsi dans l’économie mondiale. Le résultat de ce désastre financier imputable à une mainmise de type capitaliste et néo coloniale est sans appel.
Haïti est aujourd’hui l’un des pays les moins développés au monde, avec un taux de chômage variant de 50 à 80 %. Sur une population estimée à 10,85 millions d’habitants, 80 % des personnes vivent sous le seuil de pauvreté et 44% sous le seuil de pauvreté extrême , avec de surcroît une tragique insécurité .
La leçon à tirer de cette histoire tragique d’Haïti est l’incontestable prédominance des faits économiques sur l’action politique au cours d’une période donnée, et la sous estimation des rapports de force. Le rapport de force est un piège qui produit dans les relations internationales une escalade de violence — qu’elle soit de nature morale, économique, ou militaire — fortement toxique et destructive, car dès qu’elle vous aspire, elle vous prive de discernement.
Il se caractérise par une relation dominant-dominé et se résume à une logique binaire : la loi du plus fort.
C’est cette absence de discernement et la sous estimation des rapports de force par Toussaint Louverture et Dessalines qui ont plongé implicitement Haïti dans le chaos.
De fait, mes divergences avec les tenants de l’autonomie portent pour l’essentiel sur la problématique de la temporalité. Oui, je réitère une fois de plus que le temps de la politique n’est pas celui de l’économie. Chaque individu possède son propre rapport au temps. Et notre construction psychologique en est en partie responsable. La façon de dire le thème des changements permanents qui touchent aujourd’hui la société antillaise nous interpelle finalement en ce qu’elle n’apparaît pas propre à une catégorie spécifique de problèmes d’ordre idéologique purement identitaires, mais se repère à de multiples niveaux de responsabilités dans l’organisation économique et sociale de notre modèle de société. Le contexte de changement permanent de la société antillaise doit être impérativement relié à l’influence de la mutation de la société française.
C’est en ce sens que j’ai précédemment écrit que l’État français n’est autre dans cette affaire d’évolution institutionnelle aux Antilles que le maître de l’échiquier et le président Macron le maître des horloges. Aussi les mises en récit, de la notion d’autonomie doivent être soumises à une temporalité plus cyclique, vécue et dite non plus sur un mode affectif, émotionnel, et idéologique passéiste au sens phénoménologique du terme, mais sous l’angle de la prédominance de l’économie sur le politique. La problématique de la prédominance de l’économie sur le politique traverse l’histoire des sociétés humaines et s’impose avec une acuité renouvelée dans les contextes contemporains.
Les dysfonctionnements économiques agissent comme un prisme à travers lequel s’entrelacent les maux sociétaux, sociaux, institutionnels, idéologiques et identitaires. À chaque étape critique de l’histoire, ces défaillances ont exacerbé les fractures sociales et les tensions politiques, mettant en lumière une dynamique où l’économie devient non seulement une force structurante, mais également un vecteur de déséquilibres et de contestations.
Un exemple récent et particulièrement frappant de cette réalité se trouve dans les exactions observées en Nouvelle-Calédonie et en Martinique, où des entreprises ont été la cible privilégiée des violences. Ces actes traduisent un malaise profond, au croisement de tensions sociales, historiques et psychologiques. Pourtant, alors même que les institutions publiques semblaient épargnées, les demandes adressées à l’État français par les élus locaux pour financer la reconstruction révèlent une ironie amère : dans un contexte de finances publiques dégradées, ces revendications soulignent la dépendance structurelle des politiques locales aux dynamiques économiques nationales et globales.
Ce paradoxe de l’économie comme force motrice apparaît encore plus clairement dans l’histoire de Haïti, un pays dont le développement a été entravé par des logiques économiques néocoloniales depuis son indépendance en 1804. La révolution des esclaves, si elle a marqué une rupture politique majeure, a simultanément précipité l’effondrement de l’économie de l’île. Ce traumatisme initial a été aggravé par la dette imposée par la France en 1825, une rançon d’indépendance qui a durablement asphyxié l’économie haïtienne.
L’histoire tragique de la Banque nationale d’Haïti, créée sous la tutelle du Crédit industriel et commercial (CIC), illustre comment les mécanismes financiers ont été utilisés pour maintenir une emprise sur le pays. En rapatriant en France les ressources essentielles, le système bancaire a empêché les investissements nécessaires à la construction des infrastructures et institutions indispensables au développement.
Le cas haïtien illustre de manière spectaculaire comment l’économie peut supplanter le politique et dicter les rapports de force sur la scène internationale. La dette d’Haïti, qui a coûté à son développement entre 21 et 115 milliards de dollars, a eu des conséquences désastreuses, plongeant le pays dans une pauvreté extrême et le rendant incapable de s’insérer dans l’économie mondiale. Cette réalité met en lumière la logique binaire de la domination économique, où la loi du plus fort prévaut et prive les acteurs politiques de leur capacité d’action et de discernement.
Dans un contexte global marqué très récemment par une crise inflationniste et une instabilité géopolitique croissante, les enjeux économiques et financiers dominent de nouveau les débats, reléguant souvent les considérations politiques au second plan. En France, le retour du protectionnisme et les tensions autour des ressources énergétiques accentuent cette tendance.
Les Antilles françaises, en particulier la Martinique et la Guadeloupe, ne font pas exception. Alors que les débats sur l’autonomie politique se multiplient, il apparaît clairement que tout changement de statut aura un coût financier et économique significatif. Ce coût, bien que rarement explicité par les décideurs locaux, pèse sur les perspectives d’évolution institutionnelle et sur la capacité des territoires à répondre aux financements de nouvelles compétences pour satisfaire les besoins de leurs populations.
Cette dépendance de la politique à l’économie reflète également une temporalité divergente. Là où les décisions politiques se veulent immédiates et réactives, les transformations économiques nécessitent des investissements et des réformes à long terme. Les politiques locales, souvent guidées par des impératifs électoraux, privilégient la satisfaction instantanée des revendications populaires, tout en sous-estimant les risques systémiques et les défis structurels. Ce décalage temporel est particulièrement visible dans les propositions d’autonomie, présentées comme une solution miracle mais rarement accompagnées d’une analyse économique et financière rigoureuse.
Dans ce contexte, le prisme économique ne peut être ignoré. Les mutations de la société antillaise doivent être envisagées à travers une analyse approfondie des modèles économiques sous-jacents, de leurs contraintes et de leurs impacts sur les relations sociales et institutionnelles. L’exemple d’Haïti rappelle avec force que l’absence de vision économique à long terme et la sous-estimation des rapports de force peuvent avoir des conséquences catastrophiques.
L’histoire nous enseigne que la prédominance de l’économie sur le politique n’est pas une fatalité, mais une dynamique qu’il convient de comprendre et de maîtriser pour éviter qu’elle ne devienne un piège destructeur. C’est en ce sens que nous estimons que la priorité est de s’attaquer à la refonte du modèle économique actuel.
Ainsi, la question fondamentale reste posée : l’économie reprendra-t-elle bientôt totalement la main sur le politique ? Les décideurs, face aux défis climatiques, technologiques, économiques et sociaux, auront-ils la lucidité et le courage d’élaborer des stratégies qui intègrent les temporalités et les interdépendances entre ces deux sphères ? A défaut, le spectre de l’histoire pourrait bien se répéter, plongeant les sociétés qui font preuve de naïveté coupable dans une spirale de crises où les rapports de force économiques écrasent les aspirations politiques et sociales.
» Bèf fon pa konèt malè bèf món «
Traduction littérale : Le bœuf des fonds ne connaît pas le malheur du bœuf des mornes.
Moralité. A chacun ses problèmes, peu importe les apparences , avec l’idée qui peut être résumée grossièrement ainsi : Chacun doit participer selon ses possibilités et chacun doit recevoir selon ses nécessités.
*Economiste