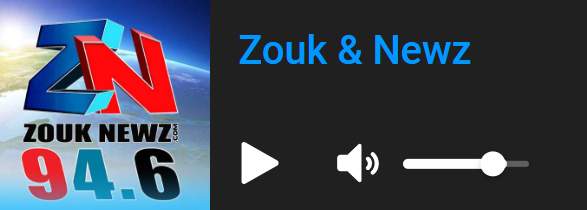PAR FRED RÉNO
Par ce titre volontairement provocateur, je souhaite montrer les limites d’un discours ambiant selon lequel nos élus n’ont pas montré leur capacité à gérer l’existant et ne mériteraient donc pas d’avoir plus de pouvoir.
Pour dissiper toute ambigüité, notre réponse à cette question est claire, nos élus ne sont pas plus incompétents que d’autres et il n’y a aucune raison de penser qu’ils le seraient intrinsèquement.
En réalité la critique est plus subtile voire plus pernicieuse. Ce discours tenu par une partie de la population, par certains universitaires et des acteurs politiques s’accompagne rarement d’une démonstration ou de l’idée qu’il s’agirait d’une exclusivité guadeloupéenne et martiniquaise. On trouvera des personnes pour déclarer sans hésitation que les élus sont incompétents sans donner des raisons sérieuses pour le démontrer.
« Ils sont incompétents parce qu’ils sont incapables de résoudre les problèmes du quotidien, l’eau, les déchets ». Cette affirmation est à prendre au sérieux parce qu’elle repose sur un constat implacable. « Vous avez la compétence, on ne voit pas les résultats ». On voit comment se traduit la supposée incompétence, mais, au-delà du constat, on ne sait pas pourquoi ils seraient tous incompétents.
Un autre type d’arguments repose sur le rapport des élus à ce qu’il est convenu d’appeler l’intérêt général.
Là encore l’argument doit être pris au sérieux. Souvent l’intérêt particulier prend le pas sur le collectif. Des cas de corruption sont révélés et pénalement sanctionnés. C’est la preuve, par conséquent, de leur existence.
Enfin, une autre critique qui leur est adressée concerne leur rapport à l’électorat qui reposerait plus sur des logiques clientélistes que des logiques rationnelles, comme nous l’enseigne le célèbre sociologue allemand Max Wéber. Nous serions loin d’une gestion politico-administrative rationnelle-légale qui caractériserait l’organisation des sociétés dites modernes.
En fait, aucun système politique n’a réussi à vaincre complètement ces dysfonctionnements dont on aurait tort de croire qu’ils sont localisés exclusivement dans les pays en développement. Même les plus modernes ne parviennent pas à éviter la corruption et le clientélisme au point de se demander parfois si ces fléaux qui touchent tous les systèmes politiques ne participent pas à la régulation sociale. Dans la plupart des situations, il s’agit de phénomènes fondés sur une relation sociale inégale mais solidaire par laquelle corrompus et corrupteurs, clients et patrons, trouvent leur compte au détriment de l’éthique et le plus souvent du reste de la population.
Ces situations ne sont donc pas propres à nos pays mais ne sont pas pour autant excusables. En réalité la question qui se pose et qui amène certains à douter des capacités de nos élus est d’un autre niveau et d’une autre nature.
Dire que nos élus n’ont pas exploré le champ des compétences qu’ils ont et ne sont pas habilités par conséquent à en demander d’autres ou à changer de statut est une appréciation politique. A ce titre, je pense qu’elle relève d’une confusion et équivaut à une « condamnation à perpétuité » de nos élus pour délit permanent d’incompétence.
La confusion porte sur la compétence et le pouvoir.
Les deux seraient indifféremment utilisés par le sens commun, comme s’ils étaient substituables. Lors d’entretiens récents menés par notre équipe de recherche, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, nous a opportunément déclaré : « Compétences ne veut pas dire pouvoir. Une compétence octroyée à une collectivité c’est une compétence de droit d’agir. Ce sont des actes d’exécution que l’on fait le plus souvent dans l’intérêt de l’État. Vous délivrez un permis de construire mais vous ne faites pas du droit de l’urbanisme. Vous n’avez aucun pouvoir normatif, aucun puisque vous ne pouvez pas changer même pas une virgule – et d’ajouter en créole – pa an patat’. »
Ce faux débat sur les compétences s’accompagne souvent d’une critique encore plus acerbe lorsqu’est introduite la faculté de dérogation et d’habilitation. Autre sésame que nos élus n’utiliseraient pas assez, sans que l’on précise, même de manière hypothétique, les raisons de cette sous-utilisation de moyens de déroger au droit commun ou de faire la loi sur place. Deux habilitations en Guadeloupe, une sur la formation et une sur l’énergie. Trois en Martinique, sur le transport, l’interdiction d’installation de fermes photovoltaïque sur les terres agricoles et une sur la formation professionnelle.
Les raisons et la volonté de faire la loi semblent donc réelles. Pourquoi pas alors plus d’habilitations et plus régulièrement ? Est-ce une nouvelle fois l’illustration de l’incompétence supposée de nos élus ? N’est-ce pas aussi une forme d’autoflagellation collective ?
En effet, comment expliquer que, depuis 1946, la Guadeloupe comme la Martinique voient se succéder des hommes politiques à la tête de nos institutions, dont on reconnait mérite et qualités, le plus souvent après leur mort, mais qui seraient incapables de faire progresser leur pays ?
C’est comme si nous condamnions définitivement nos élus alors qu’ils sont prisonniers d’un modèle politique qui leur donne, ainsi qu’à ceux qui les condamnent, l’illusion du pouvoir. Ce modèle par lequel on a des compétences mais pas le pouvoir concourt à l’irresponsabilité. Il fait de l’acteur local une victime permanente de choix parfois irrationnels qui peut compter sur un État-recours centralisateur. Le tout s’inscrivant dans un écosystème bien intégré et conservateur de dépendance-ressource vivace. Tous les acteurs, même contestataires, tous les secteurs, alimentent cette dépendance-ressource parce qu’ils y trouvent un intérêt matériel ou symbolique.
Pour l’heure, la volonté politique locale se heurte à la complexité des procédures qui empêche une réelle capacité de prise de décision des élus et du coup les rend coupables d’incompétence. Il y a des analyses éclairantes de juristes remarquables sur la difficulté à prendre des habilitations et à mettre en œuvre la faculté de dérogation. On pense notamment à Stéphane Diemertz et à l’étude récente et pertinente du professeur guadeloupéen de droit public, Dominique Blanchet, vraisemblablement le meilleur juriste antillais sur ces questions.
En conclusion, le changement doit porter moins sur les compétences que sur le système politico-administratif local et le rapport du territoire à l’État. Il faut desserrer le verrou étatique et favoriser une autonomie locale avec un pouvoir normatif accru et une nouvelle architecture institutionnelle. Il faut que ceux qui décident pour la collectivité soient contrôlés par une assemblée délibérante. Celle-ci doit pouvoir renverser ce pouvoir exécutif en cas de défaillance. En Martinique, le président Marie-Jeanne et son conseil exécutif étaient en passe d’être renversés par une assemblée qui l’avait pourtant élu. Par ce changement, ceux qui ont le pouvoir exécutif doivent assumer leurs responsabilités
En Guadeloupe, on en est loin car le défi est double. Il s’agit de convaincre la population de l’intérêt d’une collectivité unique à l’instar de ce qui s’est passé en Guyane et en Martinique. Il s’agit aussi de saisir cette opportunité pour inscrire la réduction du nombre d’élus, le pouvoir normatif et la responsabilisation dans la revendication d’évolution.
Autrement dit la réunion du congrès des élus du 12 juin n’est qu’une étape nécessaire mais pas suffisante du changement. Seule la population consultée en décidera.
*Professeur de science politique, directeur du CAGI
La photographie de Fred Réno est de Gilles de Lacroix