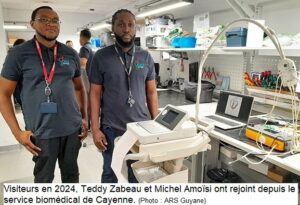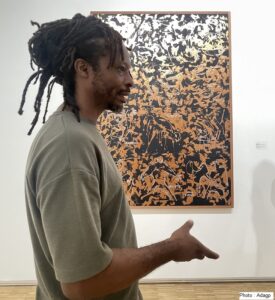PAR JEAN-MARIE NOL*
De manière inédite et synchrone, les crises à répétition et de natures variées (sociales, écologique, économique, énergétique, etc.) qui ont jalonné ces deux dernières décennies en particulier, ont mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures de la Guadeloupe en situation critique comme leur rôle stratégique.
Les investissements publics dans les infrastructures, rendus nécessaires par les contraintes budgétaires des collectivités locales , ont explosé dans les années 2000. Les infrastructures permettent aux pays d’être productifs, de jouir d’une certaine qualité de vie et de connaître une progression économique en stimulant la croissance, en créant des emplois et en améliorant la productivité, la qualité de vie et l’efficience.
En Guadeloupe, c’est là dans ce contexte que la revendication d’une plus grande autonomie politique semble s’effriter sous le poids des crises répétées de l’eau de la construction et du logement. Alors que certains élus locaux continuent de plaider pour un renforcement des compétences locales, la gestion défaillante de dossiers essentiels du ressort des élus locaux, tels que l’eau, le logement, la souveraineté alimentaire et la vie chère met en lumière les difficultés structurelles d’une gouvernance locale déjà à bout de souffle. Cette situation interroge sur la pertinence d’accorder un pouvoir local élargi lorsque les compétences actuelles semblent mal maîtrisées, voire abandonnées à elles-mêmes.
La crise de l’eau en Guadeloupe illustre parfaitement cette incapacité. En pleine période de mouvement social, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) se trouve non seulement confronté à des actes de sabotage « injustifiables et irresponsables », mais aussi à une paralysie interne due à une grève de ses agents depuis fin janvier. Près d’un Guadeloupéen sur trois se retrouve privé d’eau potable, soit environ 112 000 personnes, une situation qui a même atteint un habitant sur deux avant les premières réparations.
Pourtant, cette crise de l’eau ne se limite pas aux récents actes de malveillance. Elle s’inscrit dans une longue série de défaillances. Depuis sa création par la loi en 2021, le SMGEAG accumule les difficultés financières, affichant une dette colossale de 55 millions d’euros. La mauvaise gestion interne, exacerbée par une gouvernance chaotique, a conduit à la démission successive de son président en octobre 2024 puis de son directeur général il y a quelques jours.
Les problématiques internes s’ajoutent à une gestion technique déplorable : vols de matériel, vannes fermées sur des réservoirs, forages mis à l’arrêt. Les sabotages de mars 2024 avaient déjà privé 130 000 foyers d’eau pendant plusieurs jours, prouvant que cette crise n’est pas un accident isolé mais bien le symptôme d’un dysfonctionnement profond.
Ce naufrage de la gestion de l’eau en Guadeloupe remet en cause la crédibilité de la revendication autonomiste. Comment prétendre à une autonomie renforcée, avec davantage de compétences locales, alors même que la gestion de services essentiels échappe au contrôle des élus locaux ?
L’eau, bien commun fondamental, devrait être l’exemple d’une gestion publique exemplaire, or il n’en est rien. L’incapacité à assurer ce service vital aux habitants met en lumière les limites d’une gouvernance qui, au lieu de résoudre les crises, semble les subir.
La situation n’est guère plus reluisante sur le front du logement. La crise du logement en Guadeloupe prend également des proportions dramatiques. Avec environ 10 000 demandes de logements sociaux insatisfaites, le territoire voit sa population souffrir de la hausse des loyers et du manque criant de logements sociaux.
A cela s’ajoute un secteur de la construction en pleine déroute, marqué par une chute vertigineuse de 51,4 % dans le secteur des logements collectifs sur les douze derniers mois. Cette pénurie de logements contribue à renforcer la précarité de nombreux habitants, accentuant les inégalités sociales.
Le parallèle entre ces deux crises est frappant. Qu’il s’agisse de l’eau ou du logement, le constat est le même : les autorités locales peinent à exercer leurs compétences de manière efficace. Cette défaillance pose une question cruciale : pourquoi renforcer les compétences locales alors que les prérogatives actuelles ne sont pas correctement assumées ?
Si l’autonomie vise théoriquement à rapprocher le pouvoir des citoyens pour mieux répondre à leurs besoins, en pratique, elle risque d’entraîner un affaiblissement des services publics si elle ne s’accompagne pas d’une gouvernance responsable et rigoureuse.
En outre, la demande d’autonomie ne peut faire abstraction du contexte financier et économique de l’île. Avec un SMGEAG au bord de la faillite et un secteur du logement en panne, la Guadeloupe manque cruellement de ressources financières pour assumer seule des compétences élargies. L’accompagnement financier de l’État apparaît plus que jamais indispensable pour stabiliser ces secteurs en crise. Une autonomie politique sans moyens concrets ne serait alors qu’un leurre, une promesse vide de sens qui risquerait de laisser la population livrée à elle-même face aux défaillances de la gestion locale.
Et que dire de la crise du logement en Guadeloupe qui prend une tournure préoccupante, marquée par une combinaison de facteurs économiques, sociaux et structurels qui laissent entrevoir un véritable « changement d’époque ». En seulement deux ans, le surendettement des ménages a bondi de 38 %, selon l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM). Cette explosion de la précarité financière est révélatrice d’un mal plus profond : une inadéquation flagrante entre le coût des loyers et les capacités financières des habitants.
De nombreux Guadeloupéens peinent aujourd’hui à assumer leurs mensualités de loyer, englués dans une spirale infernale de mal-logement qui ne cesse de s’aggraver.
Les données publiées par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal) en 2024 dressent un constat alarmant : environ 10 000 demandes de logements sociaux restent insatisfaites sur l’île. Derrière ce chiffre se cachent des familles, des personnes isolées, des travailleurs précaires, tous en quête d’un toit décent. Pourtant, loin de répondre à cette demande croissante, le secteur de la construction en Guadeloupe s’effondre.
La dernière note de conjoncture de la Cellule Économique Régionale de la Construction (CERC) Guadeloupe révèle un déclin spectaculaire de 51,4 % dans le secteur des logements collectifs sur les 12 mois précédant avril 2024. Une chute vertigineuse qui dépasse largement celle des logements individuels purs (-13,9 %) ou groupés (-8,3 %).
Les raisons de cette crise sont multiples. Tout d’abord, le contexte inflationniste persistant pèse lourdement sur le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). La flambée des prix des matériaux, en partie due aux taxes environnementales et aux tensions sur les chaînes d’approvisionnement, grève les marges des promoteurs et freine le lancement de nouveaux projets. À cela s’ajoutent des taux d’intérêt bancaires élevés, rendant l’accès au crédit particulièrement difficile. Dans un territoire insulaire où le financement des projets immobiliers est déjà un défi, cette conjoncture financière réduit considérablement la capacité d’investissement des entreprises du secteur.
La crise démographique que traverse la Guadeloupe amplifie le phénomène. La population diminue, et avec elle, les besoins en logements évoluent. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la taille des foyers se réduit, générant une préférence pour des logements plus petits (T2/T3) au détriment des grandes unités familiales (T4/T5). Cette mutation des besoins fragilise encore davantage le marché des logements collectifs, traditionnellement orienté vers des familles nombreuses.
Les répercussions économiques de cette crise du logement sont dévastatrices. Les entreprises locales de construction, qui dépendent en grande partie des projets immobiliers d’envergure, voient leur activité s’éroder. Cette chute de la demande affecte directement l’emploi : le secteur du BTP enregistre déjà une baisse de 1,8 % de ses postes salariés au premier trimestre 2024. Moins de chantiers, c’est aussi moins de sous-traitance, moins d’artisans mobilisés, moins d’investissements dans l’économie locale.
Au-delà de l’aspect économique, le ralentissement de la construction pourrait rapidement engendrer une pénurie de logements. Si la demande en logement social reste forte, notamment dans les zones urbaines comme Pointe-à-Pitre ou Basse-Terre, l’insuffisance de nouveaux projets menace d’accentuer la crise. Les ménages les plus précaires risquent de se retrouver sans solution durable, tandis que la spéculation immobilière pourrait tirer les prix vers le haut, aggravant ainsi l’exclusion de nombreux Guadeloupéens surtout les jeunes du marché locatif.
Face à cette situation, la question de la réhabilitation des logements existants devient cruciale. Un nombre important de logements en Guadeloupe sont jugés indignes, souvent insalubres, avec des infrastructures défaillantes. Investir dans la rénovation de ce parc immobilier permettrait non seulement d’améliorer les conditions de vie de nombreux habitants, mais aussi de redynamiser le secteur du BTP par des projets plus accessibles financièrement que de nouvelles constructions.
Il est également urgent de revoir la politique de logement social sur l’île. L’État, les collectivités locales et les bailleurs sociaux doivent repenser leurs stratégies pour s’adapter aux nouvelles réalités démographiques et économiques. Des solutions innovantes, telles que la promotion de l’habitat intermédiaire ou l’incitation à la construction de petites unités adaptées aux personnes seules ou aux couples sans enfants, pourraient contribuer à désengorger la demande.
Enfin, la question de l’accompagnement financier des ménages doit être au cœur des politiques publiques. L’augmentation du surendettement est le symptôme d’une population en difficulté, qui peine à équilibrer ses dépenses courantes. Un renforcement des dispositifs d’aide, comme les allocations logement ou les aides à la rénovation , permettrait de soulager temporairement les budgets tout en contribuant à améliorer le parc existant.
La crise du logement en Guadeloupe dépasse largement le simple enjeu immobilier. Elle reflète un basculement sociétal, un changement d’époque où les anciens modèles ne fonctionnent plus. Si rien n’est fait rapidement, le risque est grand de voir cette crise se transformer en véritable fracture sociale, avec des conséquences profondes sur la cohésion de l’île. Plus qu’une urgence, il s’agit d’une nécessité absolue : redonner aux Guadeloupéens la possibilité de se loger dignement, dans des conditions adaptées à leurs moyens et à leurs besoins.
Il convient également de s’interroger sur la responsabilité des élus locaux dans cette situation. Si certains défendent ardemment l’idée d’un pouvoir local renforcé, d’autres préfèrent se défausser sur l’État dès lors que les difficultés apparaissent. Cette ambivalence alimente une défiance grandissante de la population à l’égard de ses dirigeants.
Pour que la revendication autonomiste regagne en crédibilité, il serait nécessaire que les élus locaux fassent d’abord la preuve de leur capacité à gérer efficacement les compétences dont ils disposent déjà. L’urgence est de restaurer la confiance en montrant que l’autonomie ne se résume pas à un slogan politique mais se traduit par des actions concrètes et bénéfiques pour la population.
En définitive, la vacuité de la revendication d’autonomie en Guadeloupe apparaît avec acuité au regard des crises actuelles. Loin d’incarner une solution aux problèmes du territoire, elle risque d’aggraver une situation déjà critique si elle n’est pas accompagnée d’une profonde réforme de la gouvernance locale.
Avant de songer à un élargissement des compétences, il semble indispensable de remettre de l’ordre dans les services publics existants, de renforcer la transparence et la responsabilité des élus, et surtout de garantir aux Guadeloupéens un accès fiable aux services essentiels à travers un changement de modèle économique. Ce n’est qu’à ce prix que l’autonomie pourra redevenir un projet politique crédible et porteur d’espoir pour l’île.
*Economiste