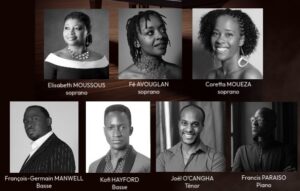PAR JEAN-MARIE NOL*
Un grand pays, un pays digne de ce nom, est un pays capable de regarder en face ses erreurs — et elles sont grandes — et ses difficultés — qui ne le sont pas moins. Les sujets d’inquiétude sont présentement innombrables. Il en est certains toutefois qui émergent avec une force criante et qui résultent des vicissitudes du passé.La capacité à gouverner dans les années qui suivent se joue pour beaucoup sur la pertinence et la précision de notre diagnostic de l’état inquiétant de la France.
Lorsque s’y rejoignent l’éthique de la conviction et celle de la responsabilité, le nouvel environnement de dépression de la société française devrait nous interpeller car substantiellement approprié à la réalité des problèmes du pays. , Actuellement plus personne ne dispose de la légitimité nécessaire pour affronter des choix difficiles pour modifier la donne à court et moyen terme . Et le « way of life » proposé par la société de consommation actuelle devient illusoire car hors de portée pour toute une partie de la population.
La France s’est désarmée depuis bien longtemps sur le plan sociétal et sécuritaire .Un sentiment de déliquescence et de délitement de la société française s’impose de manière anxiogène . Peut-on donc discerner, par-delà anecdotes et combats partisans, des ressorts profonds du processus de décomposition sociale ?
Certains ont été bien décrits, mais on ne l’a pas toujours vraiment évalué à sa juste mesure. Aucun pays au monde ne sacrifie autant sa propre histoire, au nom de la repentance et du politiquement correct, que la France. Championne de l’autoflagellation, en proie à la déliquescence de son école, à la repentance coloniale beaucoup trop tardive et au danger du multiculturalisme, la France s’enfonce dans une perte d’identité totale. L’un des nouveaux paramètres du système international est l’affaissement de la France . La raison ? Le pays est malade de son Histoire.
La France ne contrôle plus l’évolution de sa société du fait d’erreurs majeures d’appréciation commises précédemment . Dire le réel, c’est le chemin qu’avait ouvert Péguy en invitant à toujours dire ce que l’on voit, mais surtout à toujours, ce qui est plus difficile, à tenter de comprendre l’origine de ce que l’on voit comme désordre sociétal. C’est là la raison pour laquelle nous avons décidé de rédiger sous la forme d’une alerte un article de fond retraçant l’historique des décisions politiques et sociétales majeures qui selon moi ont contribué à défaire la France, tout en exposant les critiques formulées à l’époque et en établissant un lien avec les problématiques actuelles.
Pourquoi cette situation de déliquescence de la société française et antillaise nous oblige-t-elle collectivement ? Parce que tous les courants dits de gouvernement y ont pris leur part.Mon approche sera factuelle et historique, en prenant soin de rappeler les contextes législatifs et sociétaux de chaque mesure citée à l’origine des principaux problèmes que rencontre aujourd’hui la France à savoir : le regroupement familial, l’abolition de la peine de mort, la loi sur le non-cumul des mandats, la limitation du mandat présidentiel et la fin du service militaire.
Pour ce faire, j’ai décidé de m’atteler à une rétrospective sur les grandes décisions législatives d’ordre politiques et sociétales françaises qui ont façonné le déclin de la société française et laissé aujourd’hui l’empreinte d’un héritage controversé ayant entraîné le désordre au sein de la société française et antillaise. C’est là dans ce contexte que l’immigration et l’insécurité sont désormais devenus une crise chronique aux effets politiques déstabilisants .Depuis plusieurs décennies, la France fait face à une problématique complexe mêlant immigration, insécurité et terrorisme.
Cette situation, marquée récemment par une série d’attentats islamistes et de crimes perpétrés par des individus souvent en situation irrégulière, met en lumière les difficultés structurelles des autorités à garantir la sécurité publique. L’inefficacité apparente des dispositifs légaux, notamment en matière d’expulsion des étrangers sous le coup d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), alimente un climat de défiance envers les institutions et renforce la polarisation politique autour des questions migratoires et sécuritaires. Cette crise multidimensionnelle interroge non seulement la capacité de l’État à protéger ses citoyens mais aussi la résilience de la démocratie française face à la montée des extrêmes politiques.
La répétition des attaques terroristes au couteau et des crimes liés au narcotrafic, impliquant des ressortissants étrangers en situation régulière ou irrégulière, souligne les défaillances des politiques migratoires et sécuritaires françaises. Nombre de ces assaillants étaient déjà connus des services de police, voire des services de renseignement, pour des antécédents de radicalisation ou de délinquance. Pourtant, leur maintien sur le territoire national, malgré des décisions administratives d’expulsion, révèle les limites d’un État de droit confronté à ses propres contradictions. Entre protection des libertés individuelles et impératif de sécurité collective, la France peine à trouver un juste équilibre, exposant ainsi la population à des menaces persistantes.
Le dispositif des OQTF incarne à lui seul cette impuissance. Chaque année, des milliers d’étrangers font l’objet de cette mesure, mais seuls une très petite minorité d’entre eux quittent effectivement le territoire. Plusieurs obstacles expliquent cet échec : la difficulté à obtenir des laissez-passer consulaires de pays d’origine peu coopératifs comme l’Algérie, l’encombrement des centres de rétention administrative ou encore les recours juridiques permettant de retarder, voire d’annuler, l’expulsion. À cela s’ajoutent des contraintes européennes et internationales, notamment en matière de droit d’asile et de protection des droits fondamentaux, qui limitent la marge de manœuvre de l’exécutif. Ainsi, malgré des annonces politiques régulières promettant davantage de fermeté, la réalité opérationnelle reste souvent décevante.
Ce contexte nourrit une défiance croissante de l’opinion publique envers les institutions. De nombreux Français considèrent que l’État ne parvient plus à assurer sa mission régalienne de sécurité. Les perceptions d’insécurité, bien qu’amplifiées par une couverture médiatique parfois sensationnaliste, reposent sur une réalité tangible : des attentats meurtriers, des agressions quotidiennes et une criminalité liée au narcotrafic omniprésente dans certains quartiers. La frustration populaire se cristallise autour d’un sentiment d’abandon, particulièrement dans les zones urbaines sensibles, où les habitants se sentent exposés à une violence endémique sans réponse adéquate de la puissance publique.
L’impact politique de cette situation est majeur. Depuis des années, l’insécurité et l’immigration occupent une place centrale dans le débat public. Les partis politiques dits « de gouvernement » peinent à proposer des solutions convaincantes, laissant ainsi un espace béant aux formations politiques plus radicales. L’extrême droite, en particulier, s’empare de ces sujets pour alimenter une rhétorique sécuritaire et identitaire. En pointant du doigt l’immigration comme source de tous les maux, elle parvient à capter une part importante de l’électorat, y compris au sein des classes populaires et des territoires périurbains, traditionnellement acquis à la gauche ou au centre. Cette dynamique n’est pas sans danger pour la démocratie française, car elle pousse l’ensemble du spectre politique à se durcir sur ces questions, au risque d’éroder les principes républicains de tolérance et d’ouverture.
À moyen terme, la persistance de cette crise pourrait avoir des conséquences profondes sur le paysage politique français. Une nouvelle montée des extrêmes, qu’ils soient de droite ou de gauche, semble probable si la situation ne trouve pas d’apaisement. La fragilisation des partis traditionnels, déjà marquée par l’effondrement du Parti socialiste et les difficultés du parti Renaissance voire des Républicains, pourrait s’accentuer, ouvrant la voie à des recompositions politiques imprévisibles. Le danger réside également dans une potentielle radicalisation du débat public, où la question migratoire deviendrait le prisme unique à travers lequel seraient envisagées toutes les politiques publiques, au détriment d’autres enjeux tout aussi cruciaux, tels que la transition écologique, l’éducation ou la lutte contre les inégalités.
Pour éviter cette dérive, il apparaît nécessaire de refonder la politique migratoire et sécuritaire sur des bases plus solides et plus pragmatiques. Cela passe par un renforcement des moyens dédiés à l’exécution des OQTF, une meilleure coopération diplomatique empreinte de fermeté avec les pays d’origine, mais aussi par une politique de prévention de la radicalisation plus ambitieuse. L’enjeu est de restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de l’État à les protéger tout en préservant les principes fondamentaux de l’État de droit. Seule une approche équilibrée, alliant fermeté et humanisme, permettra de sortir de l’impasse actuelle sans céder aux sirènes populistes.
En définitive, la question de l’immigration et de l’insécurité en France dépasse le simple cadre de la gestion administrative et policière. Elle engage une réflexion plus large sur l’identité nationale, la cohésion sociale et l’avenir du modèle républicain. Dans un monde marqué par les crises migratoires, les menaces terroristes et les tensions géopolitiques, la France doit trouver la voie d’une politique responsable et efficace, capable de concilier sécurité et solidarité. Faute de quoi, les fractures actuelles risquent de s’approfondir, rendant encore plus difficile la tâche de reconstruire un vivre-ensemble aujourd’hui fragilisé.
En effet , depuis plusieurs décennies, la France a traversé de profondes mutations politiques et sociétales, marquées par des décisions législatives majeures qui continuent d’alimenter les débats publics. Ces réformes, adoptées sous des gouvernements de différentes sensibilités politiques, avaient pour ambition de répondre aux défis de leur temps, mais nombre d’entre elles sont aujourd’hui perçues par une partie de la population comme les racines incontestables des problématiques contemporaines du pays.
En analysant le regroupement familial, l’abolition de la peine de mort, la loi sur le non-cumul des mandats, la réduction du mandat présidentiel et la fin du service militaire, il est possible de retracer l’évolution d’une société en proie au pessimisme et en quête de cohésion, mais parfois confrontée aux effets indésirables de ses choix.
Le regroupement familial, instauré en 1976 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, visait à permettre aux travailleurs immigrés de faire venir leurs familles en France. Dans un contexte où l’immigration économique, principalement en provenance du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, était encouragée pour répondre aux besoins de main-d’œuvre, cette mesure se voulait avant tout humanitaire. Elle devait favoriser l’intégration des familles immigrées en offrant un cadre de vie plus stable et en permettant une meilleure scolarisation des enfants.
Cependant, dès l’origine, les détracteurs du regroupement familial ont mis en garde contre une potentielle pression migratoire incontrôlée et des difficultés d’intégration culturelle. Avec le temps, ces inquiétudes ont pris de l’ampleur, notamment face à l’apparition de communautés parfois perçues comme vivant en marge de la société française, alimentant ainsi le sentiment d’insécurité, les tensions identitaires et les débats sur la laïcité, l’assimilation , l’intégration et la gestion chaotique de l’immigration responsable de la montée des extrêmes .
Plus de doute dans mon esprit que cette complexe problématique de l’immigration devrait se régler à terme par l’élargissement d’une fracture ouverte de la société française et se terminer par un processus de guerre civile en France.
L’abolition de la peine de mort en 1981, portée par le ministre de la Justice Robert Badinter sous la présidence de François Mitterrand, a marqué un tournant historique en France, faisant du pays un modèle en matière de défense des droits de l’homme. L’époque était marquée par un idéal humaniste fort, où la justice se devait d’être irréprochable et où la peine capitale était considérée comme une violation des principes fondamentaux. Néanmoins, cette réforme a rapidement suscité des oppositions, notamment chez ceux qui y voyaient une réponse inadaptée face à l’augmentation de la criminalité.
Personnellement ,je n’étais pas favorable à un rétablissement de la peine de mort, mais aujourd’hui je m’interroge car force est de souligner que cette thématique va resurgir prochainement dans le débat public avec la multiplication des actes criminels et surtout terroristes. Aujourd’hui, face à la recrudescence de certains crimes particulièrement atroces et d’une violence indicible , une partie de l’opinion publique et certains mouvements politiques vont remettre en question cette abolition, estimant que l’absence de sanction ultime et d’effectivité de la perpétuité pourrait participer à un sentiment d’impunité grandissant et donc se trouve à l’origine d’une augmentation exponentielle non seulement de la criminalité , mais surtout des actions terroristes et qui devrait devenir bientôt insupportable aux yeux des français .
La loi sur le non-cumul des mandats, adoptée en 2014 sous la présidence de François Hollande, visait à renforcer la démocratie en empêchant les élus nationaux de cumuler leur fonction avec un mandat exécutif local. L’objectif affiché était de favoriser le renouvellement de la classe politique et d’éviter les conflits d’intérêts. Cependant, cette mesure a également eu pour effet de distancier les parlementaires des réalités locales, créant parfois un fossé entre les élus nationaux et leurs territoires.
Les opposants à cette réforme avaient alors prévenu que cette perte de lien direct avec le terrain affaiblirait la représentation des citoyens, une crainte qui se matérialise aujourd’hui par l’apparition d’un facteur de radicalité et par une montée de la défiance envers les institutions politiques ainsi qu’une une instabilité politique marquée par des alternances fréquentes et des difficultés à gouverner sur le long terme.
La réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans renouvelable une seule fois , mise en place après le référendum de 2000 sous Jacques Chirac, avait pour but de synchroniser les élections législatives et présidentielles, afin de renforcer la cohérence des majorités politiques. Si cette réforme visait à limiter les périodes de cohabitation, elle a également conduit à une accélération du rythme politique, où chaque président doit désormais gouverner avec une échéance électorale constamment proche.
Ce phénomène contribue à l’instabilité politique actuelle, où les gouvernements peinent à mettre en œuvre des réformes structurelles par crainte de l’impopularité, favorisant ainsi une forme d’immobilisme perçu comme un manque de vision à long terme pour le pays. Nous en payons actuellement les conséquences.
Enfin, la fin du service militaire obligatoire en 1997 sous la présidence de Jacques Chirac a marqué la fin d’un rite de passage pour des générations de jeunes Français. Destinée à professionnaliser l’armée et à s’adapter aux nouvelles formes de conflit, cette décision s’est toutefois accompagnée d’une perte de lien social et civique.
Le service militaire permettait non seulement de renforcer la cohésion nationale en brassant des jeunes de tous horizons sociaux, mais aussi d’inculquer des valeurs de discipline et de respect de l’autorité. L’absence de cette institution a été régulièrement associée à l’augmentation des incivilités et de la délinquance juvénile, laissant un vide dans l’éducation civique des jeunes générations.
L’ensemble de ces décisions, prises dans des contextes spécifiques, reflète l’évolution des choix de société opérés par la France. Si chacune de ces réformes répondait à des enjeux précis, leur accumulation et leurs conséquences inattendues interrogent sur la capacité des sociologues et dirigeants à anticiper les effets à long terme de leurs analyses et réflexions sociologiques et politiques.
Aujourd’hui, alors que la France se trouve confrontée à des défis majeurs en matière de cohésion sociale, de sécurité et de stabilité politique, ces débats devraient bientôt ressurgir avec une particulière acuité, rappelant combien il est essentiel de concilier humanisme, pragmatisme et vision prospective stratégique pour construire un avenir apaisé , mais en l’état actuel des choses, la route vers l’apaisement risque de s’avérer longue et être particulièrement cahoteuse .
« Tout chaplé ni kwa a-yo »
Traduction littérale :Tout chapelet a sa croix.
Moralité : Toute médaille a son revers
*Economiste et chroniqueur