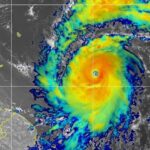PAR JEAN-MARIE NOL*
Le monde change à toute vitesse. Et avec lui, ses certitudes vacillent. Dans un contexte où le libre-échange perd sa légitimité et où les économies nationales redéfinissent leurs priorités, la Guadeloupe et la Martinique se trouvent une fois de plus au cœur d’un séisme économique mondial sans en être les initiateurs.
Ces territoires ultramarins, périphériques par leur géographie mais centraux par les questions qu’ils posent à la République, voient se profiler un retour brutal de la vie chère, nourri par une conjonction de crises internationales et de choix politiques déstabilisants. Le mirage d’un monde connecté, fluide, régulé par le commerce mondial, semble appartenir au passé.
Depuis plus de soixante ans, le dogme du libre-échange a guidé les décisions économiques des grandes puissances, porté par une foi inébranlable en ses vertus : croissance, baisse des prix, partage des richesses avec les pays émergents . Mais les faits ont fini par trahir les promesses.
La mondialisation, vantée pour sa capacité à enrichir les nations, a révélé ses failles : désindustrialisation, précarisation des classes moyennes, destruction des écosystèmes locaux. Et à mesure que ces effets délétères se sont imposés, les opinions publiques ont basculé dans la défiance. Cette méfiance s’est transformée en réaction politique avec le populisme.
Le Brexit, la montée du protectionnisme, le retour des aides d’État en Allemagne et, surtout, la réélection de Donald Trump à la tête des États-Unis avec un programme économique ultranationaliste ont acté la fin d’une époque.
En quelques semaines, le président américain a bouleversé l’ordre commercial mondial. En instaurant des droits de douane de 25 % sur l’Europe, parfois même au-delà de 100 % sur certains produits de Chine , Washington ne se contente pas de réorienter sa politique économique : elle inflige un choc frontal à l’Europe. La France est particulièrement exposée, ses entreprises vulnérables, son tissu productif mis à rude épreuve.
François Bayrou, Premier ministre, ne cache pas son inquiétude : la récession menace, les pertes d’emploi s’annoncent massives, les investissements se figent. Le ministre de l’Économie, Éric Lombard, alerte quant à lui sur les 28 000 entreprises françaises déjà affectées, et les perspectives pour les mois à venir sont aussi sombres qu’imprévisibles. Et si l’économie hexagonale vacille, c’est tout l’édifice budgétaire qui s’effondre avec elle, fragilisant mécaniquement les dotations versées aux collectivités locales.
Dans ce tableau noir, les régions d’outre-mer occupent une position particulièrement vulnérable. La Guadeloupe et la Martinique, déjà confrontées à une vie chère chronique, voient ressurgir un spectre qu’elles n’ont jamais véritablement éloigné. Ces îles dépendent largement des importations pour leur consommation quotidienne : denrées alimentaires, équipements, produits de première nécessité, carburants.
Toute hausse des prix à l’international, aggravée par des barrières douanières ou des tensions logistiques, se répercute directement sur les ménages. Et dans une économie locale peu diversifiée, au tissu productif étroit, la capacité de résilience reste très limitée.
À cela s’ajoute un autre facteur aggravant : la baisse prévisible des dotations de l’État aux collectivités locales. Paris, contraint par une dette publique de plus de 3 200 milliards d’euros, est désormais en procédure de déficit excessif vis-à-vis de la Commission européenne.
Le « quoi qu’il en coûte » appartient au passé, et les arbitrages budgétaires s’annoncent sévères. En première ligne de ces coupes : les territoires dits non-prioritaires, souvent trop éloignés des centres de pouvoir pour infléchir les choix. La Guadeloupe et la Martinique risquent donc de subir une double peine : hausse des prix et contraction des aides publiques.
La Banque centrale européenne elle-même s’inquiète : la guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde pourrait relancer une spirale inflationniste. Les tarifs douaniers imposés aux entreprises européennes seront en partie répercutés sur les consommateurs des Antilles. Déjà, certains analystes estiment que l’inflation pourrait atteindre 4,3 % dès le prochain mois de juin.
Une telle dynamique, dans un contexte de croissance ralentie, entraînerait une baisse de la consommation, une contraction de l’activité économique et, in fine, un appauvrissement généralisé. Pour les territoires ultramarins, cela pourrait signifier des prix toujours plus élevés dans les supermarchés, une pression supplémentaire intenable sur les classes moyennes et une marginalisation économique accentuée pour les publics les plus précaires.
Pourtant, cette crise pourrait aussi être l’occasion d’un sursaut. Car le libre-échange tel qu’il a été conçu n’a jamais réellement bénéficié à la Guadeloupe ni à la Martinique. Ces territoires ont été maintenus dans une dépendance structurelle : zones de consommation passive, plutôt que moteurs de production. Ils n’ont pas su – ou pas pu – développer un modèle endogène de développement.
La fin de la mondialisation heureuse pourrait alors ouvrir une brèche, une opportunité pour repenser les priorités : localiser et développer certaines productions locales, valoriser les circuits courts, encourager les initiatives d’investissements locales, renforcer l’autonomie économique et énergétique. Mais cette transition nécessite un volontarisme politique sans faille, une vision à long terme, des investissements lourds, et un accompagnement structuré de l’État.
Reste que, dans l’immédiat, l’urgence domine. Le retour en force de la vie chère aux Antilles n’est plus une perspective abstraite : c’est une réalité qui s’installe, lentement mais sûrement. Dans un monde où les certitudes économiques s’effondrent, la fragilité des territoires insulaires se transforme en vulnérabilité critique. Comme le disait Jacques Prévert : « On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. »
Pour la Guadeloupe et la Martinique, ce bruit est celui des étiquettes qui grimpent, des budgets familiaux qui s’effondrent, et des horizons économiques qui se referment. À moins, peut-être, d’un sursaut collectif pour mettre de côté l’idéologie politique stérile , et enfin se concentrer sur la réforme du modèle économique actuel.
*Economiste