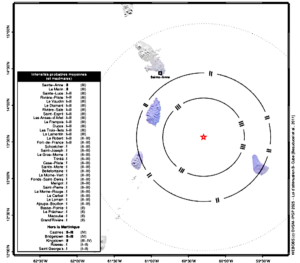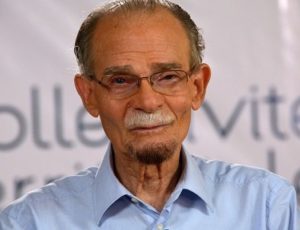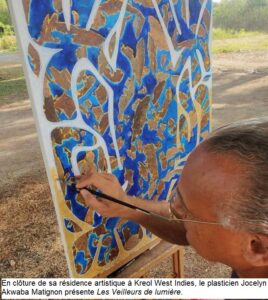PAR JEAN-MARIE NOL*
À l’heure où les mutations technologiques accélèrent la transformation des économies mondiales, la Guadeloupe, lourdement dépendante des financements publics, ne dispose ni des ressources financières ni des compétences managériales nécessaires pour affronter les défis de l’avenir dans un contexte de profondes incertitudes économiques et financières.
L’autonomie de la Guadeloupe, présentée comme une voie vers une plus grande liberté politique et culturelle, se heurte à un obstacle fondamental : l’impossibilité de viabiliser économiquement cette ambition dans le contexte dégradé des finances publiques de la France et de la révolution technologique actuelle et à venir, notamment avec l’essor de l’intelligence artificielle.
L’horizon 2035 révèle déjà les prémices d’une mutation économique d’une ampleur sans précédent, et la Guadeloupe, sans ressources financières endogènes solides et sans préparation stratégique sérieuse, s’avère dramatiquement vulnérable avec une situation financière très difficile de la France hexagonale.
En effet, la France traverse aujourd’hui une grave crise budgétaire, comme l’a rappelé récemment le Premier ministre François Bayrou, soulignant un déficit public attendu à 5,4 % du PIB en 2025 et une dette nationale à un niveau historique de près de 3500 milliards d’euros à 113 % du PIB. Dans ce contexte d’effort budgétaire généralisé, marqué par la nécessité de 40 milliards d’euros d’économies d’ici 2026 – dont 8 milliards sur les collectivités locales –, il est illusoire de penser que la Guadeloupe serait épargnée.
Bien au contraire, une évolution vers davantage d’autonomie institutionnelle devra nécessairement s’accompagner d’une réduction inévitable des dotations de l’État. Par ailleurs, déjà que les compétences locales actuelles sont en grave échec notamment sur la problématique de l’eau, il est vain de spéculer que le cadre d’autonomie, tant espéré pour répondre aux défis sociaux, politiques et économiques structurels de demain, puisse s’édifier sur des bases financières fragilisées.
D’où l’urgence, par des temps incertains, d’une réflexion lucide sur les véritables enjeux politiques, économiques et sociaux de notre futur collectif.
Alors que certains élus et politologues appellent de leurs vœux lors d’un congrès une autonomie de la Guadeloupe, il est impératif de rappeler une réalité incontournable : sans ressources financières solides, et surtout en l’absence de capacités managériales, cette autonomie serait un saut dans l’inconnu. Aujourd’hui, l’économie guadeloupéenne repose massivement sur les transferts financiers de l’État français, qui soutiennent non seulement les services publics mais aussi, indirectement, l’ensemble du tissu économique local. Dans un contexte d’autonomie, la diminution programmée de ces dotations fragiliserait immédiatement les finances publiques du territoire.
Les collectivités locales, déjà en grande difficulté budgétaire, verraient parallèlement leurs recettes propres diminuer sous l’effet d’un double choc : la contraction de l’emploi liée à l’automatisation massive des métiers traditionnels et la faiblesse structurelle du tissu productif local.
Les emplois administratifs, fortement représentés en Guadeloupe, sont parmi les premiers menacés par l’essor de l’intelligence artificielle, qui remplacera d’ici 2035 plus de 90 % des tâches de bureau selon l’OCDE. La disparition de ces emplois entraînerait une baisse de la consommation et donc des recettes de l’octroi de mer, une diminution drastique des cotisations sociales, une réduction du produit des impôts locaux et une explosion du chômage, privant les collectivités de leviers fiscaux essentiels.
Face à la révolution numérique, la Guadeloupe ne dispose ni des infrastructures nécessaires ni d’un vivier suffisant de compétences de haut niveau pour créer de nouvelles filières économiques compétitives. Le déficit criant de cadres dirigeants formés aux métiers du numérique, couplé à l’exode massif des jeunes talents, réduit considérablement les marges d’action pour affronter les défis du changement climatique, de la transition énergétique ou de la souveraineté alimentaire.
Demander l’autonomie sans avoir sécurisé les bases économiques indispensables pour la soutenir revient à promettre l’effondrement social et financier du territoire. Car l’autonomie, loin de se décréter, se construit par une montée en puissance des capacités productives, éducatives et technologiques. Demain avec le changement statutaire, la Guadeloupe serait privée du soutien de l’État, et n’aurait ni les ressources, ni les structures, ni les compétences pour relever les défis majeurs qui s’annoncent.
À l’heure où l’intelligence artificielle redessine à grande vitesse les économies mondiales, croire que l’autonomie serait une réponse magique est une dangereuse illusion. La seule voie réaliste pour la Guadeloupe est de changer son modèle économique en renforçant dès maintenant ses capacités d’innovation, d’éducation et d’investissement, avec le soutien nécessaire de l’État, avant même d’envisager un quelconque changement de statut.
Car sans base économique solide, l’autonomie ne serait qu’un mot vide, précipitant notre archipel dans une crise historique dont il serait difficile de se relever.
L’économie guadeloupéenne repose aujourd’hui encore massivement sur la dépense publique. Près de 40 % de l’emploi est lié directement ou indirectement à l’administration, et une part importante du PIB dépend des transferts financiers en provenance de l’État français.
Dans ce contexte, une autonomie sans ces appuis conduirait mécaniquement à un assèchement brutal des ressources budgétaires nécessaires pour maintenir les services publics, financer les infrastructures et soutenir les secteurs économiques.
Or, cette fragilité structurelle est aggravée par l’émergence d’un bouleversement technologique sans précédent : l’intelligence artificielle et l’automatisation.
Dans une société où l’administration est un refuge traditionnel contre le chômage, la disparition massive de ces postes pourrait provoquer une crise sociale majeure. Les agents publics, les secrétaires, les comptables, les gestionnaires de dossiers, tous verront leurs fonctions menacées par des systèmes plus rapides, moins coûteux et plus fiables. Sans le filet protecteur des dotations de l’État français, la Guadeloupe autonome se retrouverait seule face à cette déferlante.
La situation est d’autant plus préoccupante que les compétences humaines requises pour s’adapter à cette nouvelle économie sont largement absentes.
Face à la généralisation de l’IA, d’autres secteurs stratégiques de la Guadeloupe sont également menacés. Le transport, vital pour l’insularité, sera bouleversé par les véhicules autonomes, réduisant drastiquement les besoins en chauffeurs de taxis, de bus, de camions. La conséquence immédiate sera la fonte des recettes percues par la région sur le carburant. L’industrie agroalimentaire, déjà fragile, intégrera davantage de robots intelligents, supprimant les emplois peu qualifiés sans que des reconversions ne soient aujourd’hui organisées.
Le tourisme, secteur clé, ne sera pas épargné : réservations automatisées, expériences personnalisées par des applications dopées à l’IA, robotisation de l’accueil hôtelier réduiront les marges d’emploi si l’offre touristique locale n’est pas capable de se réinventer dans l’hyper-personnalisation humaine et culturelle.
Le risque est donc immense : celui d’un effondrement économique accéléré par la double peine d’une contraction massive de l’emploi salarié traditionnel et d’une incapacité chronique à intégrer les nouveaux circuits économiques globaux. Le départ massif des jeunes diplômés vers la métropole ou l’étranger, déjà sensible aujourd’hui, s’intensifiera, privant le territoire des forces vives nécessaires à sa transformation.
À cela s’ajoutera une aggravation des inégalités sociales : ceux qui maîtriseront les outils numériques et l’IA bénéficieront des opportunités mondiales, tandis que la majorité, privée d’accès aux compétences critiques, sombrera dans le chômage de masse et la précarité.
Or, pour espérer transformer ce bouleversement en opportunité, il aurait fallu depuis plusieurs années mettre en œuvre une stratégie d’adaptation audacieuse : investir massivement dans l’éducation aux compétences d’avenir, favoriser l’innovation locale, soutenir l’entrepreneuriat technologique, créer des passerelles solides entre savoirs traditionnels et nouvelles technologies. Ce n’est pas ce qui a été fait. Et il est désormais illusoire de penser qu’une autonomie politique pourrait compenser ces déficits systémiques. Au contraire, elle risquerait d’exacerber tous les facteurs de vulnérabilité : désindustrialisation, appauvrissement accéléré, crise des services publics, exode des talents, montée de la pauvreté.
Il est fondamental de comprendre que la Guadeloupe n’évolue pas en vase clos. Elle est insérée, qu’elle le veuille ou non, dans un monde globalisé et ultracompétitif, où les territoires qui ne parviennent pas à s’adapter rapidement aux mutations technologiques sont relégués aux marges de l’économie mondiale. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle agit comme un révélateur et un accélérateur des failles profondes du modèle économique guadeloupéen. Elle impose une course contre la montre pour la montée en compétences, la création de valeur locale, l’innovation et la résilience sociale.
Prétendre pouvoir affronter seuls ces défis titanesques, sans appui extérieur de l’État français et surtout de l’Europe qui d’ailleurs réoriente les crédits vers les pays de l’est, sans ressources fiscales locales suffisantes, sans stratégie cohérente d’adaptation, relève non seulement d’une illusion dangereuse mais aussi d’une forme d’aveuglement face à l’accélération du temps historique.
Le vieux proverbe créole « *Piman-la pa ka janmèn montwé fos ay’ *» nous rappelle que les dangers les plus redoutables sont souvent invisibles jusqu’au moment où il est trop tard. L’intelligence artificielle est ce piment silencieux qui transformera l’économie de la Guadeloupe bien plus vite que les débats politiques locaux ne le laissent supposer.
Le véritable enjeu pour la Guadeloupe n’est donc pas l’autonomie institutionnelle en soi, mais la capacité à se doter des outils économiques, technologiques et humains qui permettront de peser dans la mondialisation numérique. Sans cela, toute perspective d’autonomie ne sera qu’un saut dans le vide. Et l’effondrement économique, social et culturel sera aussi brutal qu’inéluctable.
*Economiste