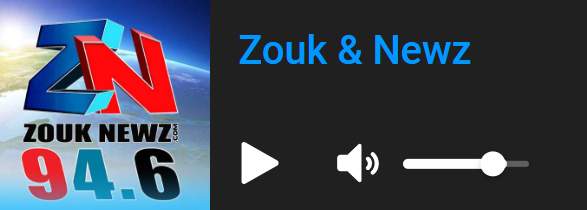PAR STEPHAN MARTENS*
Nous avons demandé à Stephan Martens de nous expliquer les liens qui unissent, après de longs combats meurtriers entre les deux nations, l’Allemande (au sens général du nom, qu’elle se soit appelée un temps Prusse ou Reich) et la France. La réconciliation entre les deux Etats et au travers d’eux, entre les deux peuples, peut être un modèle pour nos sociétés tourmentées où s’opposent encore, plus de deux siècles après l’Abolition de l’esclavage, des composantes de nos sociétés créoles.
Après trois guerres, dont deux mondiales, il était impératif de lier l’Allemagne et la France. Rappelez-nous les débuts de cette relation.
Le rapprochement franco-allemand est souvent, à juste titre, présenté comme un cas d’école en matière de transformation des relations entre anciens belligérants. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y eut des esprits éclairés en France, comme en Allemagne, parmi les membres de ce que nous appelons aujourd’hui la « société civile », qui ont martelé leur aspiration au vivre enfin en paix. De part et d’autre du Rhin, au sein des élites dirigeantes, on avait également compris qu’il fallait se soumettre à la contrainte pour la transformer en création, et il s’agissait d’abord de reconnaître que l’on a des intérêts communs – c’est le sens même du projet de Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, exposé le 9 mai 1950, en proposant la mise en commun de ce qui était à l’époque le nerf de la guerre, le charbon et l’acier. S’en est suivi le projet de création d’une Communauté économique européenne (CEE) en 1957, l’ancêtre de l’Union européenne (UE). Les signataires du traité de coopération et d’amitié franco-allemand, dit de l’Élysée, du 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, ont donné ensuite l’impulsion nécessaire afin que les responsables français et allemands transcendent la complexité de leur relation au bénéfice d’une réconciliation exemplaire au service de la construction européenne.
Depuis 1963, les procédures et structures de dialogue, d’échanges et de coopération n’ont cessé de se multiplier, dans les domaines politique, économique, culturel et militaire. À l’occasion du 25e anniversaire de la signature, en 1988, sont mis en place le Conseil franco-allemand de la défense et de la sécurité, ainsi que le Conseil économique et financier franco-allemand, et en 1989 c’est la création de la Brigade franco-allemande qui conduit à l’émergence de l’Eurocorps en 1993. Un secrétariat général pour la coopération dans chaque pays et les Conseils des ministres franco-allemands, qui se substituent aux sommets franco-allemands, sont mis en place à la suite 40e anniversaire du traité, en 2003. Le traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes, signé à Aix-la-Chapelle, le 22 janvier 2019, complète le traité de l’Élysée en passant de la volonté de coopération à celle de convergence dans plusieurs domaines, aussi bien économique que militaire ou encore transfrontalier. Aujourd’hui, les relations bilatérales n’ont aucun équivalent entre deux autres pays au monde.
Le processus de réconciliation franco-allemande pourrait-il faire sens pour les Antilles et la Guyane ?
Il n’y a pas de « recette miracle » : la réconciliation franco-allemande ne peut qu’être un stimulant pour débattre sur les conditions d’une réconciliation en général. Si un antagonisme latent entre développement économique et affirmation identitaire divise (encore) les populations aux Antilles et en Guyane, il faut bien envisager désormais des rapports nouveaux entre descendants d’esclaves et descendants de colons, leurs destins étant liés. Il faut d’abord « dépassionner » les débats sur le passé, l’étudier de manière critique, afin de mieux l’appréhender et l’assumer. C’est d’autant plus essentiel, que ce débat touche l’état d’âme de sociétés en quête d’une mémoire collective. Aussi longtemps qu’un travail sur le passé n’est effectué, le présent ne peut qu’être empoisonné par des résurgences délétères. Le choix d’un discours scientifique et l’acceptation de confrontations critiques sur les faits historiques permettent de sortir des illusions fantasmatiques. Ensuite, il est nécessaire de s’engager dans un processus de longue durée permettant de franchir un certain nombre d’étapes incontournables : reconnaître d’abord et surtout, les inconvénients de vivre dans les rancœurs du passé, reconnaître les fautes et les crimes commis par les oppresseurs, s’impliquer dans le pardon et la promesse pour sceller la concorde qui est donc possible, à condition que les concepts de « pardon » et de « réconciliation » soient combinés à l’exigence de vérité. Enfin, il faut reconnaître les intérêts communs en vue de bâtir un projet concret porté par les acteurs politiques et trouver des symboles forts ayant un effet d’entraînement à long terme – ce que le Mémorial Acte en Guadeloupe ne peut constituer, n’étant pas un lieu de mémoire incarnant l’idée d’un passé tragique partagé. Et l’enjeu c’est moins le débat sur des compensations financières que l’émergence d’un projet dynamique de société permettant de construire ce que l’on appelle un « vivre ensemble » apaisé.
« Si l’on peut s’interroger sur certaines limites du grand récit de la réconciliation franco-allemande, l’on doit aussi admettre qu’il fut et reste une leçon de tolérance et de solidarité qui peut être un modèle pour d’autres régions en conflit dans le monde. »
Les relations franco-allemandes ne sont-elles pas idéalisées ?
Depuis près de 60 ans, les responsables politiques français et allemands ont donné les impulsions nécessaires afin que les deux pays améliorent les mécanismes d’imbrication des processus de coopération et puissent se fixer les mêmes objectifs et ensuite emprunter les mêmes chemins pour les réaliser. Et on a eu tendance à magnifier cette relation, l’image émouvante de la poignée de main entre François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl, devant l’ossuaire de Douaumont, à Verdun, le 22 novembre 1984, est devenue une solide icône. C’est le processus de réconciliation qui a permis aux deux pays de se rapprocher et qui leur permet, aujourd’hui, à continuer de se rapprocher, au point de prétendre parfois former un « couple », ce que le partenariat franco-allemand n’est assurément pas, mais ce rapprochement franco-allemand possède une vraie exemplarité et a démontré une capacité à construire l’Europe de la paix et de la prospérité. Si l’on peut s’interroger sur certaines limites du grand récit de la réconciliation franco-allemande, l’on doit aussi admettre qu’il fut et reste une leçon de tolérance et de solidarité qui peut être un modèle pour d’autres régions en conflit dans le monde.
Certes, la relation franco-allemande n’est plus portée, ou beaucoup moins, par le besoin de réconciliation qui avait suscité après la Seconde Guerre mondiale des vocations fortes de part et d’autre du Rhin. Cette relation a bien changé depuis l’unification allemande de 1990, il ne faut en effet pas oublier que d’un point de vue français la division de l’Allemagne fut en réalité la condition préalable à une réconciliation avec le voisin. Or, en 1990 les paramètres traditionnels des rapports franco-(ouest)-allemands sont remis en cause par l’avènement d’une grande Allemagne souveraine au cœur de l’Europe. La défiance a parfois tendance à tempérer cette relation, surtout depuis l’échec, en 2005, du référendum en France sur le traité constitutionnel européen, alors qu’il avait été ratifié par le parlement allemand à une très large majorité.
Je suis d’ailleurs préoccupé par une sorte de surdité franco-allemande, dans des domaines clés comme celle de la politique économique, due à un net déficit de compréhension interculturelle. Les mésententes résultent de préjugés et stéréotypes qui perdurent. Les dirigeants font appel aux interprètes pour communiquer au niveau du langage, mais ils auraient bien plus besoin d’interprètes culturels pour pouvoir dialoguer à un niveau d’efficacité supérieure. La relation franco-allemande est d’abord un dialogue entre les cultures qui doit être en permanence entretenu, une plante qui s’arrose tous les matins, car un partenariat entre États, aussi solide soit-il, n’est jamais un fait acquis.
« Si le couple « imaginaire » peut être perturbé par les affinités plus ou moins prononcées entre les partenaires, le lien privilégié qui unit les deux pays n’en a pas moins une base suffisamment solide pour ne pas être remis en cause au gré de conjonctures politiques diverses. »
Ces relations ont été liées aux leaders des deux pays. Avec des hauts et des bas. Qu’en est-il avec le président Emmanuel Macron ?
Pour que les relations franco-allemandes prennent un essor spécifique après la signature du traité de l’Élysée, il a fallu adosser la réconciliation à un récit mythologique, contant l’histoire d’une réconciliation, au sens de « retour à l’union », renvoyant le plus souvent à l’idée d’une symbiose franco-allemande mythique du temps de Charlemagne. Et il a fallu installer des points d’ancrage nouveaux et communs, comme l’image du « couple » ou du tandem franco-allemand, l’amitié supposée entre les chefs d’État et de gouvernement, et en effet les « couples » général de Gaulle/ chancelier Adenauer, président Valéry Giscard d’Estaing/chancelier Helmut Schmid, président Mitterrand/chancelier Kohl, voire président Jacques Chirac/chancelier Gerhard Schröder, ont réussi à faire advenir un entre-soi qui pouvait paraître improbable à beaucoup en transformant les ennemis en amis. En définitive, la relation ne peut fonctionner comme un moteur pour l’Europe que s’il y a une entente minimale entre les dirigeants français et allemands. Mais si le couple « imaginaire » peut être perturbé par les affinités plus ou moins prononcées entre les partenaires, le lien privilégié qui unit les deux pays n’en a pas moins une base suffisamment solide pour ne pas être remis en cause au gré de conjonctures politiques diverses.
Si le président Macron a réussi à nouer des liens solides avec la chancelière Angela Merkel, en revanche, du côté allemand, il n’y a jamais eu de vraie euphorie à l’idée de voir Emmanuel Macron accéder en 2017 à la présidence de la République, on était surtout soulagé que Marine Le Pen n’ait pas été élue. En accueillant le président Macron à Berlin le 15 mai 2017, pour son premier déplacement officiel, la chancelière Merkel l’avait prévenu en citant l’écrivain Hermann Hesse : « Au début de toute chose il y a un charme », en ajoutant : « Mais pour que le charme demeure, il faut qu’il y ait des résultats à la clé ». Le charme est rompu depuis longtemps, parce que les responsables allemands face aux propositions sur l’Europe du président Macron n’ont pas su se montrer réactifs, mais parce qu’ils se sont rapidement méfiés des blocages en matière de réformes économiques provoqués par la crise sociale (« gilets jaunes »).
« Là où la France parle de politique industrielle de défense, avec un rôle fort de l’État pour coordonner et orienter, l’Allemagne se retranche derrière les politiques de ses industriels, soucieuse de ne pas laisser l’État interférer. »
Pourquoi l‘idée d’une armée européenne ne prend-elle pas ? Les embryons d’armée qu’on fait défiler dans les grandes occasions ne font pas illusion.
On ne peut nier la disparité de nos systèmes politiques et de nos cultures stratégiques. Il convient de comprendre les différences majeures des fondamentaux français et allemands dans le domaine de la défense pour pouvoir mieux les surmonter. La relation intime de l’Allemagne avec la défense reste profondément marquée par le poids de la mémoire du régime nazi obsédé par le pouvoir militaire, le courant qui prône une résolution par la diplomatie et la négociation est influent. L’idéologie du pacifisme d’après-guerre irrigue toujours le subconscient des Allemands, qui préfèrent parler en termes de « responsabilité » pour ne pas donner l’impression qu’ils sont en quête d’une politique de puissance. Du côté français, comme du côté britannique, s’engager en opération reste un enjeu majeur, comme en témoigne l’Initiative européenne d’intervention (IEI) lancée par le président Macron. En Allemagne, la Bundeswehr est une armée « parlementaire », c’est-à-dire sous le contrôle du parlement fédéral, qui seul a le pouvoir de donner le feu vert à une action militaire, alors qu’en France c’est le président de la République qui ordonne l’intervention des forces militaires. Dans le domaine de l’industrie de défense, les approches sont également très différentes. Derrière le terme « industrie de défense », Paris entend « défense », Berlin « industrie ». Là où la France parle de politique industrielle de défense, avec un rôle fort de l’État pour coordonner et orienter, l’Allemagne se retranche derrière les politiques de ses industriels, soucieuse de ne pas laisser l’État interférer. Intégrer la composante industrielle à la définition de la coopération de défense paraît évident pour un esprit français, beaucoup moins vu du côté allemand.
Les divergences fondamentales ne sont pas liées à des intérêts irréconciliables, mais aux cultures nationales. C’est pourquoi le traité d’Aix-la-Chapelle invite les deux pays à développer et à renforcer une culture commune des forces armées et une industrie de la défense européenne. Paris et Berlin vont être obligées d’engager un dialogue poussé sur ces questions stratégiques. Mais soyons optimistes : à chaque crise ou défi majeur, l’Europe communautaire s’est renforcée. Après tout, l’échec, en 1954, de la Communauté européenne de défense (CED) a conduit à la mise en place de la CEE. La crise économique mondiale de 2008 suivie de la crise de la zone euro a conduit à la mise en place de mécanismes et d’actions de solidarité monétaires et financière nouveaux et inédits. Si le chemin sera long pour la mise en place d’une vraie Europe de la défense incluant une armée « européenne », l’Union a confirmé dans chaque crise l’un des enseignements fondamentaux de son historie, l’axiome de Jean Monnet : « L’Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. »
« Au sein de l’Union, il n’y a pas
de volonté de domination de l’Allemagne, mais il y a une influence actuellement prépondérante sur la conduite des affaires européennes, en raison notamment de la puissance économique. »
L’économie étant ce que l’on sait, sur les gros dossiers c’est chacun pour soi.
Les divergences sur des dossiers économiques sont inévitables et logiques, car elles répondent à des réalités : priorité aux intérêts nationaux, traditions historiques, contexte géographique. Voyez l’affaire autour du gazoduc Nord Stream 2, qui va relier la Russie à l’Allemagne via un pipeline de 1 230 kilomètres sous la mer Baltique, qui divise l’Europe pour des raisons commerciales et géopolitiques, et pour laquelle Paris n’a pas soutenu Berlin ; en même temps, les deux capitales se sont mises d’accord le 21 juillet 2021 sur l’exploitation du successeur d’Ariane 5 et le dossier des mini-fusées : cet accord donne un avenir institutionnel et commercial à Ariane et garantit l’accès autonome de l’Europe à l’espace, puisque la France et l’Allemagne sont les deux plus gros contributeurs au budget de l’Agence spatiale européenne (ESA).
Les germanosceptiques s’agacent des principes qui guident l’Allemagne depuis plus d’un siècle, mais chaque partenaire a son « modèle ». À l’inverse de la France « colbertiste », l’Allemagne applique l’ordolibéralisme, ce courant de pensée libéral apparu en Allemagne dans les années 1930 selon lequel la mission de l’État est de créer un cadre normatif permettant la concurrence libre et non faussée dans les entreprises. L’Allemagne reste une puissance industrielle majeure dans le monde, elle dispose de ce fameux Mittelstand (réseau de petites et moyennes entreprises majoritairement familiales) très performant à l’exportation, véritable force de frappe et colonne vertébrale de l’économie allemande. Mais la France n’a pas à rougir, elle est la sixième économie mondiale (l’Allemagne est quatrième), elle reste une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. La France et l’Allemagne sont des pays concurrents sur les marchés extérieurs, mais n’ignorons pas qu’en parallèle les acteurs français et allemands peuvent adopter des positions communes, tel le « Manifeste franco-allemand pour une politique industrielle européenne adaptée au XXIe siècle », signé le 18 février 2019 par les ministres français et allemand de l’Économie, Bruno Le Maire et Peter Altmaier, et dans lequel on perçoit que le partenaire allemand arrive à prendre (timidement) ses distances avec les préceptes de l’ordolibéralisme lorsqu’il s’agit de soutenir les filières économiques stratégiques.
Au sein de l’Union, il n’y a pas de volonté de domination de l’Allemagne, mais il y a une influence actuellement prépondérante sur la conduite des affaires européennes, en raison notamment de la puissance économique. Que d’incompréhensions et de jugements sur le voisin faute de comprendre la cohérence de la culture des uns et des autres.
« Autant l’opinion publique allemande a une vision contradictoire de l’islam, ballotée entre un sentiment prédominant de méfiance et d’altérité, et considérant (encore) que l’islam ne fait pas partie intégrante de la culture allemande, autant les Turcs d’origine sont bien intégrés à tous les niveaux au sein de la société allemande. »
Avec une grande communauté turque, l’Allemagne joue-t-elle le jeu face aux provocations du président turc Erdogan ? Ne va-t-elle pas un jour faire entrer ce loup dans la bergerie ?
L’Allemagne est de loin le premier pays d’Europe à abriter une communauté turque aussi importante. Mais les 3 millions d’individus sont loin de constituer une communauté homogène, divisés qu’ils sont aux plans religieux, social, mental et politique, et plus ou moins désireux ou capables, soit de s’intégrer ou de s’assimiler, soit de vivre en une communauté séparée dans leur pays d’accueil. Autant l’opinion publique allemande a une vision contradictoire de l’islam, ballotée entre un sentiment prédominant de méfiance et d’altérité, et considérant (encore) que l’islam ne fait pas partie intégrante de la culture allemande, autant les Turcs d’origine sont bien intégrés à tous les niveaux au sein de la société allemande. Plus d’un Turc sur trois résidant en Allemagne a adopté la nationalité allemande. Aujourd’hui, des dizaines de milliers de chefs d’entreprise, de hauts fonctionnaires et de responsables politiques ont des origines turques.
Le président Recep Tagyyp Erdogan est en effet coutumier d’un certain nombre de provocations, au point d’ailleurs que les négociations sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l’Union, débutées en 2005, sont au point mort, les relations entre Bruxelles et Ankara s’étant très fortement tendues depuis la tentative manquée de putsch de juillet 2016 et la répression touchant opposants et journalistes qui a suivi. Ce que les dirigeants allemands recherchent aujourd’hui c’est le maintien à tout prix de leurs intérêts économiques et commerciaux. Car le partenariat germano-turc a de vieilles racines qui remontent, au moins, à l’entente entre l’empereur Guillaume II et le sultan Abdülhamid II en 1888. L’Allemagne est le premier exportateur en Turquie. Près de 3 000 entreprises allemandes sont implantées en Turquie. Réciproquement, l’Allemagne constitue le premier importateur de produits turcs.
« Jamais un pas décisif dans la construction européenne n’a été franchie sans que l’Allemagne et la France n’y aient activement contribué en s’accordant sur une position commune. »
La Grande-Bretagne est partie de l’Union, la Hongrie peut-être demain … Que devient l’axe franco-allemand quad il s’agit de convaincre ?
En 1973, à peine intégrée dans la Communauté européenne, la Grande-Bretagne exige que les conditions de son adhésion soient renégociées, refusant que sa participation financière à l’Europe soit plus élevée que les bénéfices qu’elle en retire : on peut résumer ces revendications par la célèbre formule lancée de Margareth Thatcher, le 30 novembre 1979 lors du Conseil européen de Dublin : « I want my money back ». Le Brexit ne constitue pas une surprise. Mais il ne me semble pas qu’il y ait des velléités sérieuses de la part d’autres États membres à quitter le paquebot européen. Le retour des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) dans le concert européen s’est effectué dans le cadre d’un processus de transition, gage de la restauration d’un ordre libéral et du passage à l’économie de marché, qui s’est conclu par l’adhésion à l’UE à partir de 2004. Mais ce processus a été brutal et a divisé les sociétés, une faille géoculturelle Est/Ouest est donc apparue et elle est restée longtemps impensée par les institutions bruxelloises et les capitales occidentales. Ce n’est pas pour autant que la Hongrie ou la Pologne ont émis des vœux de sortie de l’Union, malgré des discours anti-UE opportunistes, ce sont des pays qui n’oublient pas non plus le rôle d’intercesseur de leurs intérêts au début des années 1990 de l’Allemagne auprès des instances européennes en vue d’une adhésion à l’Union.
Jamais un pas décisif dans la construction européenne n’a été franchie sans que l’Allemagne et la France n’y aient activement contribué en s’accordant sur une position commune. Souvent les positions différentes entre Français et Allemands reflètent dans le même temps des divergences d’intérêts ou de perceptions qui concernent tous les États membres. Dans les négociations préalables, Paris et Berlin recherchent des lignes communes, sans pour autant anticiper de compromis, les autres partiaires peuvent se positionner d’un côté ou de l’autre. Il n’y a pas de duopole ou de directoire franco-allemand en Europe. L’affirmation de la bonne entente franco-allemande suscite jalousie ou agacement et en même temps cette entente rassure les autres pays membres : cette entente prend tout son sens parce qu’elle est au service de la construction européenne. Dans une Europe élargie c’est plus compliqué, mais le rôle spécifique et irremplaçable de préfiguration et d’entrainement du binôme franco-allemand est un truisme. Sans entente franco-allemande, l’Union n’aurait jamais pu conclure un accord, le 21 juillet 2020, au Conseil européen de Bruxelles, sur le « Plan de relance », à la suite de la crise économique provoquée par la Covid-19, et dont nous bénéficions tous aujourd’hui. Il y a eu la prise de conscience systémique, sous la pression de Paris et de Berlin, que ce qui nous est commun (le marché unique, l’union monétaire) est plus important que le chacun pour soi. La dynamique d’interdépendance et d’intégration, le « réflexe européen » l’a emporté sur les égoïsmes nationaux, d’autant que la Grande-Bretagne n’est plus là pour freiner et pour bloquer.
À partir de points de vue divergents, toujours parvenir à trouver un terrain d’entente, parfois au prix d’importants efforts, dans l’intérêt de l’Europe : voici ce qui constitue le défi singulier, mais aussi la grandeur historique de la relation franco-allemande. Et je suis certain qu’il continuera d’en être ainsi après le départ de la chancelière Angela Merkel, car, fait rassurant, les trois candidats le plus sérieux à sa succession sont des Européens convaincus et d’ardents partisans de l’amitié franco-allemande.
« Il est certain que l’Europe n’avancera plus dans un certain nombre de domaines qu’à condition qu’il y ait consensus
au sein d’un groupe d’États membres
prêt à s’engager dans un processus d’approfondissement plus audacieux
de l’UE. »
Et si l’Europe c’était celle de Charlemagne tout simplement. On y rajoutera l’Italie et l’Espagne …
Pour bannir les tendances centrifuges qui menacent de déchirer l’Europe, certains responsables politiques français ont lancé des projets d’union franco-allemande, ou de « Françallemagne », au début des années 2000, puis au milieu des années 2010, à la faveur de contextes critiques (échec du traité constitutionnel européen, Brexit). En Allemagne, le partenariat franco-allemand y est perçu de manière plus neutre, ce n’est pas une affaire de passion et on n’aspire pas à ce type d’assemblage. Tout au long des années 1990 les dirigeants allemands avaient cependant formulé plusieurs propositions en vue de renforcer l’architecture politique de l’Union avec des pays membres prêts à aller plus loin dans l’intégration. On se souvient du document « Réflexions européennes », du 1er septembre 1994, du groupe parlementaire conservateur de la CDU/CSU, qui avait lancé l’idée d’un « noyau dur » précurseur destiné à renforcer le cadre institutionnel de l’Union, composé de cinq États fondateurs (la France, l’Allemagne et les pays du Benelux, mais sans l’Italie) et au sein de cette entreprise, la France et l’Allemagne devaient former le cœur du « noyau dur », ouvrant la voie aux autres par la qualité de leur relation préexistante. Ce projet ne trouva guère d’échos en France, on était à l’époque davantage préoccupé par la prétendue volonté hégémonique de l’Allemagne réunifiée en Europe. Aujourd’hui, avec le retour du fait national, c’est devenu bien plus compliqué, puisque la vision de l’Europe a évolué et que les conceptions d’une Europe supranationale s’estompent. L’Allemagne comme la France, comme tous les autres pays membres, défend ses postions sans complexe, d’où un européisme de circonstance qui d’un côté soutient le processus de construction européenne et de l’autre cherche à mieux défendre les intérêts nationaux. Il est certain que l’Europe n’avancera plus dans un certain nombre de domaines qu’à condition qu’il y ait consensus au sein d’un groupe d’États membres prêt à s’engager dans un processus d’approfondissement plus audacieux de l’UE.
« Le plus grand défi : l’UE s’est présentée comme une puissance économique évitant les logiques traditionnelles du rapport de force, alors qu’elle doit se muer en un acteur stratégique d’envergure internationale. »
L’Europe a-t-elle un avenir ?
Oui, pour plusieurs raisons. On peut d’abord et surtout considérer que l’Europe est une expérience qui permet de gérer quotidiennement, de manière contractuelle et civilisée, des désaccords nationaux, qu’il existe un modèle européen avec des règles (acquis communautaire) et des valeurs (acquis politique) qui ont dessiné un espace communautaire à l’intérieur duquel la paix est assurée, les droits de l’Homme garantis et les injustices sociales combattues pour promouvoir la prospérité pour tous. L’Union est un modèle d’intégration et un pôle de stabilité visiblement attractif pour d’autres parties du monde. En même temps, et en conséquence, l’Europe sera confrontée de plus en plus aux tempêtes géopolitiques mondiales. À une situation politique interne « critique », avec la montée des populismes et des extrêmes, s’ajoute une ceinture géopolitique particulièrement instable, surtout dans le pourtour méditerranéen. L’Europe est donc poussée à intervenir (in)directement dans la gestion des conflits proches, l’environnement la force à abandonner son « innocence géopolitique ». La construction européenne doit s’articuler avec les régions voisines, comme le Maghreb, la Turquie, la Russie, l’Ukraine.
La construction européenne avancera sans doute face aux nécessités imposées par l’action au sens large. Les théoriciens des relations internationales parlent « d’engrenage institutionnel », ainsi s’élabore peu à peu l’organisation qui permet de survivre. Les pères fondateurs de la CEE, peu portés à l’abstraction, avaient compris instinctivement que les nations devaient s’interconnecter pour qu’émerge l’unité afin de se « serrer les coudes ». Pour survivre, l’Union devra se « penser » dans la compétition mondiale en s’ouvrant aux autres, pour ne plus faire figure de « dernier végétarien parmi les carnivores » (Hubert Védrine). Ce sera le plus grand défi : l’UE s’est présentée comme une puissance économique évitant les logiques traditionnelles du rapport de force, alors qu’elle doit se muer en un acteur stratégique d’envergure internationale.
« Les territoires ultramarins, auraient tout à perdre d’une fragmentation de l’Europe, car ils sortiraient purement et simplement du champ de vision des États membres, autre que la France, et donc de leur périmètre de solidarité. »
En quoi l’Europe peut-elle être un modèle pour une grande région Antilles-Guyane ? Nos différences (spécificités) apparentes sont autant handicapantes pour ces échanges qu’elles peuvent l’être entre Portugais et Polonais …
À la base de la construction européenne, on retrouve l’idée de l’intégration économique à l’échelle régionale, ce qui implique ce que les pères fondateurs ont mis en relief à maintes reprises : l’effort de solidarité, au sens large du terme. La logique même du processus et du système d’intégration entre les États européens repose sur une mécanique, une méthode, dont un des moteurs est la solidarité. L’Union peut donc inspirer d’autres ensembles régionaux en quête d’agencement. Certes, des contraintes politiques et structurelles pèsent sur les territoires insulaires de la Caraïbe, dont les régions ultrapériphériques (RUP) de l’Union, comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane (exiguïté des marchés intérieurs, fortes contraintes naturelles, faible diversification des économies, taux de chômage important), et qui peuvent freiner les coopérations régionales. Et dans ce cadre, une chose est sûre : les territoires ultramarins, auraient tout à perdre d’une fragmentation de l’Europe, car ils sortiraient purement et simplement du champ de vision des États membres, autre que la France, et donc de leur périmètre de solidarité. N’oublions pas que l’UE reste l’acteur incontournable pour l’obtention de subventions de la politique de cohésion par le biais, notamment, du Fonds européen de développement régional (FEDER).
L’UE s’efforce justement de renforcer les liens des territoires européens avec le reste de la Caraïbe dans le cadre notamment des programmes Interreg, mis en place pour soutenir des projets de coopérations transfrontalières, transrégionales, voire transnationales. En France, la nouvelle organisation territoriale de 2015 laisse la place à 13 grandes régions dans l’Hexagone aptes à jouer un rôle majeur auprès des instances européennes, notamment pour pouvoir bénéficier des divers fonds structurels de l’UE. Constituer une entité administrative englobant une grande région Antilles-Guyane pourrait constituer un atout certain pour ces trois RUP. Le problème est de savoir si les exécutifs et l’opinion publique dans ces territoires ont la volonté politique réelle d’aller en ce sens, et s’ils sont disposés à diminuer d’autant leur part d’autonomie lorsqu’ils sont regroupés au sein d’entités de gestions communes, afin d’être plus efficients vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs. Les intérêts communs aux trois RUP doivent être identifiés : la Guyane dépend dans sa politique de voisinage davantage de bons rapports avec l’Amérique latine et centrale qu’avec la Guadeloupe ou la Martinique. Il faut trouver de forts dénominateurs communs combinant intérêts et solidarité d’une part, plus d’ouverture et plus de volonté d’échanges d’autre part. Car il s’agit aussi de savoir ce que l’on veut faire avec une grande région : attirer davantage d’investisseurs dans la grande distribution, développer une ingénierie spécifique dans le domaine de la protection de l’environnement, mieux faire au niveau qualitatif dans le domaine de l’industrie du tourisme, par exemple ? Les acteurs économiques sont en première ligne, mais il faudra également qu’au niveau des institutions culturelles ou universitaires, à la mécanique trop sclérosée ou fonctionnant selon des logiques dépassées, il y ait une prise de conscience sur la nécessité de faire circuler les savoirs, de se frotter à d’autres réalités, en Europe et dans le monde, afin que la jeunesse puisse apporter par là une réelle plus-value aux territoires d’Outre-mer. L’histoire est un puissant levier pour comprendre ce phénomène, mais la fermeture n’a jamais été une solution dans l’histoire de l’humanité. Le salut d’une grande région Antilles-Guyane passera par l’ouverture à l’Autre, à tous les niveaux.
« Qu’il s’agisse des territoires français, anglais ou néerlandais, leur intégration au sein d’associations économiques ou de coopération régionale pose problème. »
Pourrait-on envisager une grande fédération caribéenne qui ferait leur place aux régions Guadeloupe, Martinique et Guyane ? Serait-ce judicieux ?
Il y a eu, par le passé, des fédérations éphémères, la dernière en date étant la West Indies Federation, formée des colonies britanniques des Antilles. En dehors du fait que cette fédération résultait d’un acte juridique édicté par le Royaume-Uni en 1958 (et dissoute par le Royaume-Uni en 1962), il est intéressant d’observer que son échec a résulté d’une combinaison de facteurs multiples et divers, dont l’absence de soutien populaire, la concurrence du nationalisme insulaire, les divergences culturelles entre les territoires ou encore les frictions politiques entre dirigeants locaux. Aujourd’hui, le contexte géohistorique dans l’espace caribéen est tout autre, mais il faut bien constater qu’un certain nombre d’obstacles socio-économiques (barrières douanières ou réglementaires, différentiel du coût du travail et de niveau de vie, spécialisations des systèmes productifs concurrents), culturels (langues officielles différentes) ou politiques (visas, instabilité politique de l’environnement régional) réduisent souvent les possibilités d’échanges entre territoires et entités de la Caraïbe. Qu’il s’agisse des territoires français, anglais ou néerlandais, leur intégration au sein d’associations économiques ou de coopération régionale pose problème. Les RUP ne peuvent pas, par exemple, participer directement aux organismes de coopération qui regroupent des territoires indépendants, et encore moins des États, ainsi aucune suite officielle n’a encore été donnée à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique candidates depuis 2012 au statut d’État associé de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), même si la Guadeloupe et la Martinique ont pu, en 2014, adhérer en nom propre à l’Association des États de la Caraïbe (AEC). En somme, la diversité des situations ainsi que les nombreuses organisations de coopération existantes témoignent des difficultés d’intégration des territoires, notamment européens, dans une Caraïbe morcelée qui peine à s’organiser.
Il reste, et j’en suis convaincu, que l’enjeu est désormais de faire la démonstration qu’il est possible d’avancer de manière concrète en proposant des solutions adaptées à ces territoires de la Caraïbe qui partagent tant de défis communs, mais également de faire des territoires européens, les RUP, des territoires pilotes et des modèles, intégrés et acteurs dans leurs environnements régionaux, pour trouver de solutions qui s’appliqueront ensuite dans d’autres espaces du monde. Pour le secteur énergétique, par exemple, l’indépendance énergétique qui est un objectif partagé par l’ensemble des îles du monde, est, grâce au soutien de l’UE, atteignable beaucoup plus facilement dans les îles européennes. Il existe une multitude de communautés de destin pour les Outre-mer : une communauté partagée avec l’Europe, certes, mais aussi une communauté de destin avec les différentes zones géographiques qui sont en contact de ces Outre-mer.
*Stephan Martens est ancien recteur d’académie, professeur d’études allemandes et européennes à la CY Cergy Paris Université. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages portant, notamment, sur la politique étrangère de l’Allemagne.
Il vient de faire paraître L’urgence européenne Eloge de ‘engagement franco-allemand aux Presses universitaires de Bordeaux