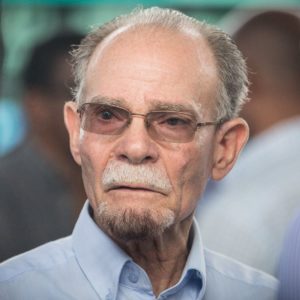PAR JEAN-MARIE NOL*
La récente décision du président américain Donald Trump d’imposer des droits de douane substantiels, notamment une taxe de 20 % sur les produits européens et 10% sur les produits de la Guadeloupe et Martinique, suscite de vives inquiétudes quant à une possible récession mondiale accompagnée d’une poussée inflationniste.
Les experts et économistes s’accordent à dire que ces mesures protectionnistes pourraient avoir des conséquences néfastes sur l’économie mondiale et, en particulier, sur la France.
Les marchés financiers ont réagi négativement à l’annonce de ces tarifs douaniers. Les indices boursiers américains et internationaux ont connu des baisses significatives, reflétant les craintes d’une escalade des tensions commerciales et d’un ralentissement économique global. Les investisseurs se tournent vers des valeurs refuges, telles que l’or, témoignant de l’incertitude ambiante.
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a mis en garde contre les effets délétères de ces guerres commerciales sur la croissance mondiale et l’inflation. Selon l’OMC, les politiques commerciales de Donald Trump pourraient réduire le commerce mondial de marchandises d’environ 1 % en volume cette année, augmentant le risque de récession mondiale.
La France, en tant que partenaire commercial majeur des États-Unis, est particulièrement vulnérable à ces nouvelles barrières tarifaires. Les secteurs français des vins et spiritueux, de l’aéronautique et de la pharmacie, qui représentent une part significative des exportations vers les États-Unis, pourraient être durement touchés.
Emmanuel Macron a réuni les filières françaises impactées par la hausse des droits de douane pour évaluer les conséquences économiques concrètes pour les différentes entreprises françaises.
Face à cette situation, l’Union européenne envisage des mesures de rétorsion pour protéger ses industries et son économie. Cependant, les économistes préviennent que de telles actions pourraient également pénaliser les consommateurs européens en augmentant les prix des produits importés.
Emmanuel Macron a dénoncé une décision « brutale et infondée » de Donald Trump et a évoqué la possibilité de suspendre les investissements français aux États-Unis en réponse aux tarifs douaniers.
En réalité , l’imposition de ces nouveaux droits de douane par les États-Unis risque de déclencher une récession mondiale, avec des effets inflationnistes notables. La France, en raison de ses liens commerciaux étroits avec les États-Unis, pourrait subir des impacts significatifs, notamment dans ses secteurs clés d’exportation.
Il est impératif pour les autorités françaises et européennes de naviguer avec prudence dans ce climat économique incertain, en équilibrant les mesures de protection de leurs industries tout en évitant une escalade des tensions commerciales qui nuirait davantage à l’économie mondiale.
Si la France entre en récession à cause des tensions commerciales et des droits de douane imposés par Donald Trump, les conséquences seraient multiples et toucheraient plusieurs secteurs de l’économie de la Guadeloupe et de la Martinique.
Une récession signifie une contraction du PIB, ce qui entraîne une réduction de l’activité économique. Les entreprises, en particulier celles dépendant des exportations vers les États-Unis et d’autres marchés touchés, verront leur chiffre d’affaires baisser. Cela pourrait les contraindre à réduire leurs investissements, voire à licencier du personnel, augmentant ainsi le taux de chômage.
Une baisse d’activité signifie moins de rentrées fiscales (TVA, impôt sur les sociétés, cotisations sociales), tandis que les dépenses publiques pourraient augmenter pour soutenir les ménages et les entreprises (allocations chômage, aides aux secteurs en difficulté). Cela risquerait d’aggraver le déficit public et d’augmenter la dette de la France, ce qui pourrait provoquer des tensions avec l’Union européenne.Historiquement, les crises économiques en France ont souvent été accompagnées de tensions sociales : manifestations, grèves, protestations contre l’inflation et le chômage.
Les répercussions économiques pourraient ainsi se traduire par une instabilité politique accrue, d’autant que l’affaire de la condamnation de Marine le Pen crée déjà des remous dans le microcosme .
En somme, une récession française déclenchée par la guerre commerciale de Trump pourrait affecter profondément le pays, de l’emploi au budget de l’État, en passant par la consommation et la stabilité sociale. Tout dépendra de la rapidité et de l’ampleur des réponses économiques apportées par le gouvernement français et l’Union européenne. Et dans le même temps, les Antilles traversent une période de transition critique, marquée par une série de bouleversements économiques, sociaux et démographiques qui redéfinissent en profondeur leur avenir.
La trajectoire actuelle de ces territoires ultramarins semble les mener vers une crise systémique, tant les indicateurs convergent vers une fragilisation accrue de leur structure sociale et économique. Si les signaux d’alerte ne sont pas pris en compte avec lucidité et réactivité, la Guadeloupe et la Martinique pourraient se retrouver dans une impasse, prisonnières d’une dynamique de déclin inexorable du fait des conséquences de la crise. Disons le très clairement la récession économique n’est plus une option à écarter d’un revers de main.
La Guadeloupe, territoire insulaire déjà confrontée à des difficultés notamment dans le BTP , pourrait bien voir son économie entrer en récession dans un contexte où la France hexagonale elle-même peine à maintenir une dynamique de croissance. Les prévisions économiques revues à la baisse pour 2025, marquées par la montée des tensions commerciales et une rigueur budgétaire accrue, laissent entrevoir un avenir incertain pour l’archipel.
Les déclarations récentes des responsables de l’Insee et de l’OFCE, pointant une consommation atone et un moral des ménages en berne, résonnent tout particulièrement dans ce territoire où l’économie est déjà plus fragile qu’en France hexagonale.
La croissance française pour 2025, initialement prévue à 1,1 %, a été successivement révisée à la baisse, les dernières estimations la situant autour de 0,7 %. Cet écart traduit la difficulté pour le gouvernement de maintenir un objectif optimiste dans un contexte mondial de ralentissement économique.
Si la France peine à trouver des relais de croissance, la Guadeloupe et la Martinique, dépendante des transferts publics et du tourisme, risque de souffrir encore davantage des conséquences d’une baisse générale de la consommation et des investissements.
La consommation, moteur essentiel de l’économie, ne montre pas de signes de rebond. En France hexagonale , la croissance des dépenses des ménages reste modeste, avec une progression attendue de seulement 0,4 % au premier trimestre et 0,2 % au second. En Guadeloupe, où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale et où le pouvoir d’achat est souvent plus contraint, ces chiffres pourraient être encore plus faibles.
L’épargne des ménages, qui aurait pu constituer un levier de relance, demeure élevée. En métropole, elle oscille autour de 18 %, et bien que son léger recul soit envisagé, les experts restent sceptiques sur un réel effet sur la consommation. En Guadeloupe et Martinique , l’attentisme des consommateurs pourrait s’avérer encore plus prononcé en raison d’un climat économique plus incertain.
Les entreprises guadeloupéennes, déjà fragilisées par des coûts d’importation élevés et une insularité qui pèse sur leur compétitivité, risquent de voir leur situation se dégrader. La politique budgétaire actuelle pourrait amputer l’investissement des entreprises de 0,5 point chaque année en 2025 et 2026, réduisant ainsi les capacités de développement et d’innovation des acteurs économiques locaux.
Avec une faible diversification économique et une dépendance marquée aux importations, la Guadeloupe pourrait connaître une contraction de son activité plus prononcée que la moyenne nationale.
Sur le plan des finances publiques, la situation est tout aussi préoccupante. La baisse de la consommation entraîne une diminution des recettes fiscales, notamment en ce qui concerne la TVA, une tendance déjà observée en France hexagonale.
La Guadeloupe, bénéficiant de nombreux dispositifs d’aides et d’exonérations, pourrait voir ces mêmes mesures remises en question si le gouvernement devait réduire ses dépenses pour compenser un déficit plus important que prévu. La stabilisation budgétaire pourrait alors se faire au détriment des aides aux collectivités locales et aux entreprises, amplifiant ainsi les difficultés économiques du territoire.
L’économie locale, déjà fragilisée, se trouve dans une situation précaire face à un environnement mondial en perte de vitesse. Les prévisions de croissance pour la France hexagonale ont été revues à la baisse, avec une estimation de seulement 0,7 % pour 2025. Cette stagnation a des répercussions encore plus lourdes en Guadeloupe et en Martinique, où la consommation, moteur essentiel de l’activité, montre des signes de faiblesse persistante.
Les ménages, confrontés à une vie chère insoutenable, adoptent des comportements d’épargne défensive, réduisant ainsi leur contribution à la dynamique économique. Le secteur entrepreneurial souffre également : les coûts d’importation élevés, combinés à une insularité qui limite la compétitivité, entravent les perspectives de développement.
Par ailleurs, la politique budgétaire adoptée par l’État ne semble pas en mesure de relancer efficacement l’économie locale. Les restrictions budgétaires risquent d’amputer les investissements et d’accentuer la contraction de l’activité. La baisse des recettes fiscales, due à la diminution de la consommation, menace directement la viabilité des collectivités territoriales, déjà sous tension.
Les aides publiques, longtemps perçues comme un rempart contre la précarité, pourraient être réduites, contraignant les territoires à une austérité encore plus marquée.
Le secteur du tourisme, pourtant essentiel à l’économie antillaise, n’échappe pas à cette conjoncture défavorable. La baisse du pouvoir d’achat des ménages en métropole impacte directement la fréquentation des îles, tandis que l’augmentation des coûts du transport aérien, sous l’effet des taxes supplémentaires sur les billets, de la crise énergétique et des tensions commerciales, rend la destination moins attractive. Cette situation met en péril de nombreux emplois et fragilise les infrastructures hôtelières, dont la rentabilité devient incertaine.
Les défis structurels liés aux infrastructures publiques sont un autre point d’inquiétude majeur. L’exemple en Martinique du Transport Collectif en Site Propre (TCSP) en Martinique illustre les défaillances systémiques dans la gestion des projets d’envergure.
Les finances publiques locales, exsangues depuis plus de vingt ans, poursuivent leur inexorable détérioration. Et d’ailleurs,les compétences locales tenant à l’eau et au transport ne sont pas concluantes. En effet , en Guadeloupe, le manque d’eau dans les robinets est un problème récurrent , et en Martinique c’est le secteur du transport terrestre avec le TCSP et maritime avec les vedettes régulièrement à quai du fait de grèves, qui connait des dysfonctionnements.
La mise en place du Transport Collectif en Site Propre (TCSP) en Martinique a engendré un coût global de 378 millions d’euros, avec une contribution de 283 millions d’euros en maîtrise d’ouvrage publique. Malgré un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 60,4 millions d’euros, la gestion et l’exploitation du TCSP ont révélé plusieurs défaillances majeures, notamment dans les procédures de commande publique, des surcoûts contractuels et des difficultés opérationnelles (grèves, pannes, insécurité).
L’exploitation du TCSP s’est avérée très onéreuse avec une augmentation de 43 % de la contribution de la CTM à la délégation de service public. Cette situation laisse présager des difficultés budgétaires croissantes, notamment en raison : des coûts d’exploitation élevés par rapport aux recettes générées par les usagers, qui ne paient pas systématiquement leur trajet. D’une insécurité grandissante sur le réseau, menaçant la rentabilité du service et nécessitant des investissements supplémentaires en matière de sûreté.
D’un manque de fiabilité du service causé par des pannes fréquentes et des conflits sociaux. Les élus de l’Assemblée de Martinique ont récemment validé un projet d’extension du TCSP d’un coût estimé à 524,12 millions d’euros. Bien que cette initiative vise à améliorer la mobilité sur le territoire, elle représente un engagement budgétaire massif qui risque d’exacerber la pression financière sur la CTM. En particulier, les risques suivants doivent être pris en compte : un endettement accru pour la CTM, alors que le modèle économique du TCSP actuel ne permet pas de couvrir ses charges d’exploitation; une incertitude sur les financements européens et nationaux, qui pourraient ne pas être suffisants pour absorber l’ampleur du projet.
Des doutes sur la capacité à générer un trafic suffisant pour rentabiliser l’investissement, notamment si les problèmes de gouvernance et de sécurité ne sont pas résolus en amont. Le TCSP en Martinique représente à la fois un enjeu de développement et un défi financier majeur pour la CTM. Son exploitation actuelle met en lumière de nombreuses failles structurelles qui nécessitent des réformes urgentes avant d’envisager la mise en œuvre d’une extension.
Sans un modèle économique solide et une gestion plus rigoureuse, la poursuite du projet pourrait transformer le TCSP d’ici 2030 en un gouffre financier encore plus profond pour la Martinique qui devrait mettre en danger l’équilibre des finances de la CTM. Une réflexion approfondie sur les alternatives et les moyens d’optimiser l’existant s’impose pour Martinique transport avant de s’engager dans de nouveaux investissements massifs.
Cette affaire de nature à provoquer une crise financière sera demain une source d’inquiétude.
L’augmentation des impôts et taxes foncières , loin de résoudre la situation, pèsera sur la compétitivité des entreprises et la capacité d’achat des ménages. Face à l’impasse budgétaire, les collectivités locales peinent à envisager des solutions viables, tandis que l’Etat français, contraint par des finances déjà sous tension, ne peut plus se permettre le « quoi qu’il en coûte » d’autrefois. En effet, les finances publiques ne sont pas en reste.
La contraction de l’activité économique entraîne une diminution des recettes fiscales locales, tandis que les dépenses sociales explosent sous l’effet du vieillissement de la population et de la précarisation croissante des habitants. L’État, déjà contraint par des finances publiques tendues, ne peut plus jouer son rôle de soutien massif comme autrefois.
Les collectivités locales, déjà en difficulté, risquent donc de se retrouver face à des choix drastiques : augmentation des impôts locaux, diminution des services publics, ou endettement massif.
De ce fait, la disparition progressive de l’État providence, conjuguée à des finances publiques exsangues, limiterait la capacité d’intervention des pouvoirs publics, accélérant ainsi l’effondrement du modèle socio-économique actuel.
L’avenir des Antilles dépendra en grande partie de la capacité des décideurs, qu’ils soient politiques, économiques ou sociaux, à anticiper et à répondre aux défis posés par cette transition complexe. Loin de se limiter à une simple crise conjoncturelle, il s’agit ici d’une transformation systémique qui appelle à une remise en question profonde des stratégies de développement.
Si ces territoires veulent éviter de s’enfoncer davantage dans l’impasse, il est impératif d’adopter une vision pragmatique, ambitieuse et prospective c’est à dire résolument tournée vers l’avenir.
« Si jou pa lévé, kok-la pa ka chanté » Traduction littérale : Si le jour ne se lève pas, le coq ne chante pas.
Moralité : L’avenir appartient à ceux qui savent anticiper très tôt.
*Economiste