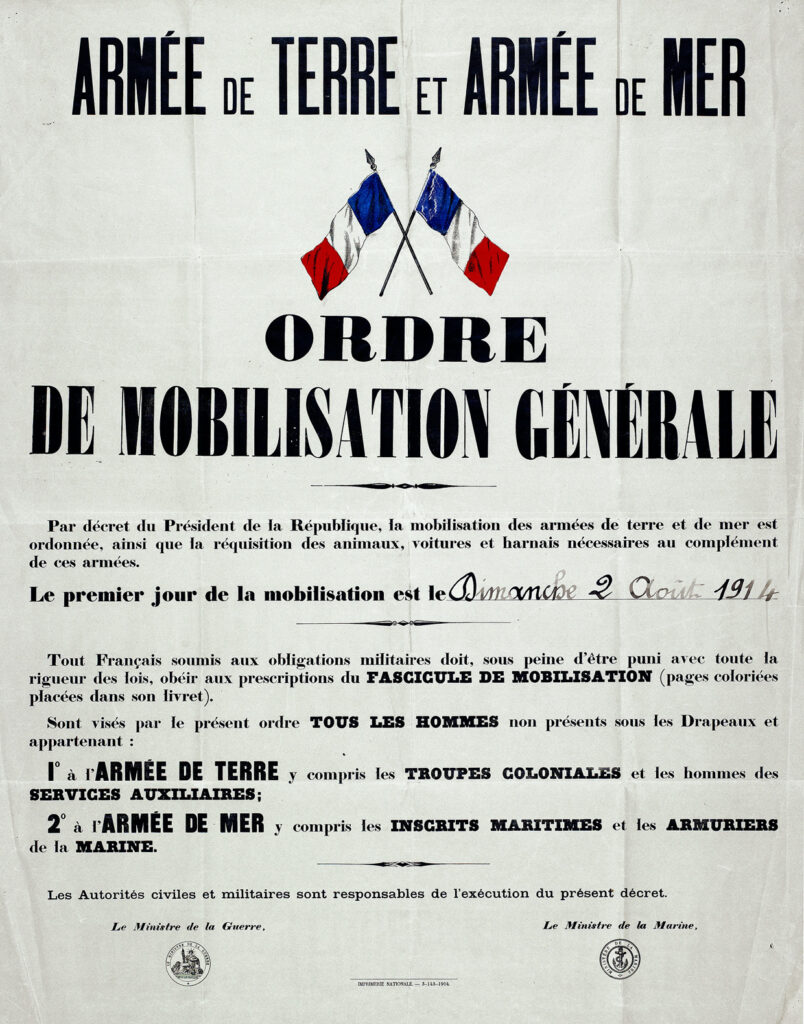PAR JEAN-MARIE NOL*
Les Antilles françaises traversent une période économique critique sans que nos élus ne prennent la mesure de l’urgence de la situation.
Entre collectivités locales asphyxiées et ménages martiniquais voire guadeloupéens submergés par l’endettement, la situation devient de plus en plus intenable. Alors que l’État impose de nouvelles restrictions budgétaires aux collectivités, les familles font face à une hausse vertigineuse du surendettement et des incidents bancaires. En Martinique, l’année 2025 s’annonce comme un tournant alarmant, révélateur d’une fragilité économique croissante.
En effet, les collectivités locales sont désormais contraintes à la rigueur budgétaire à l’instar de la CTM et pourtant c’était prévisible comme le dénotent moults de nos articles écrits bien en amont sur cette thématique.
Les collectivités locales des Antilles, déjà sous tension, doivent désormais composer avec une baisse de leurs recettes et des exigences de réduction budgétaire imposées par l’État. Dans le cadre du budget 2025, il leur est demandé de réaliser 2,2 milliards d’euros d’économies, un effort considérable qui se traduit par une compression drastique des dépenses. Régions, départements et communes sont ainsi contraints de revoir leur gestion financière à la baisse, sacrifiant parfois des investissements essentiels et réduisant considérablement les subventions aux associations et entreprises locales.
Les conséquences de ces restrictions sont déjà palpables sur le terrain en Martinique : baisse des dotations pour les infrastructures publiques, diminution des aides aux secteurs économiques en difficulté et coupes budgétaires dans les services sociaux. Cette situation renforce la précarité des territoires ultramarins, déjà marqués par un coût de la vie élevé et un taux de chômage plus important qu’en France hexagonale.
Les répercussions de cette austérité se ressentent durement sur les ménages martiniquais et guadeloupéens. L’augmentation du coût de la vie, couplée à une inflation persistante, a fragilisé le pouvoir d’achat des habitants. Selon l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), le nombre de dossiers de surendettement a explosé en 2024 avec 662 dépôts, soit une hausse de 23 % par rapport à 2023. Il s’agit d’un record historique, illustrant l’intensification des difficultés financières.
Cette tendance alarmante ne se limite pas à la Martinique. Elle s’inscrit dans une évolution générale des Outre-mer et de l’Hexagone, où les ménages peinent de plus en plus à faire face à leurs engagements financiers. En Guadeloupe , les nouvelles inscriptions au Fichier National des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ont bondi de 34 %, un chiffre qui témoigne de l’ampleur du phénomène.
Face à cette précarité croissante, les demandes d’accompagnement bancaire ont également augmenté. Le nombre de désignations du droit au compte – qui permet aux personnes exclues du système bancaire d’accéder aux services essentiels – a progressé de plus de 4 % en un an. Cette évolution montre que de plus en plus de Guadeloupéens se retrouvent dans des situations financières critiques, nécessitant un recours aux dispositifs d’inclusion bancaire.
Paradoxalement, une légère amélioration a été constatée sur un autre indicateur : le nombre de personnes inscrites au Fichier Central des Chèques (FCC) – qui regroupe les émetteurs de chèques sans provision et les détenteurs de cartes bancaires retirées pour usage abusif – a reculé de 6 % en 2024 par rapport à l’année précédente. Cette baisse peut être attribuée aux dispositifs de prévention mis en place, mais elle reste marginale face à l’explosion des autres indicateurs de fragilité financière.
Nous sommes confrontés à une crise structurelle aux effets durables.Les élus de Guadeloupe et de Martinique sont aujourd’hui confrontés à une crise économique et financière d’une ampleur inédite, qui met à nu les fragilités structurelles des territoires ultramarins. Face à l’asphyxie budgétaire des collectivités locales et à la détresse croissante des ménages, une question s’impose : pourquoi cette situation n’a-t-elle pas été anticipée ? Comment les responsables politiques, conscients des vulnérabilités économiques de leurs territoires, ont-ils pu laisser la situation se dégrader au point de compromettre l’avenir à horizon 2030 ?
L’analyse de cette crise révèle un mélange de démagogie et d’aveuglement politique, de dépendance excessive aux transferts publics et d’une incapacité à repenser le modèle économique ultramarin dans un monde en mutation. L’une des premières explications réside dans la dépendance historique des Antilles françaises à l’État central. Depuis des décennies, les collectivités locales de Guadeloupe et de Martinique fonctionnent en grande partie grâce aux dotations et subventions publiques, qui compensent un tissu économique fragile et un marché du travail largement dominé par le secteur public.
Cette dépendance structurelle a instauré une forme de passivité politique, où la gestion des finances locales repose davantage sur les décisions budgétaires de Paris que sur des stratégies autonomes de développement économique. Ainsi, lorsque l’État a annoncé des réductions budgétaires et imposé 2,2 milliards d’euros d’économies aux collectivités dans le cadre du budget 2025, cette purge était prévisible et pourtant l’impact a été immédiat et brutal, révélant un manque d’anticipation criant de la part des élus locaux. Le manque de diversification économique est une autre faille majeure que les responsables politiques n’ont pas su corriger à temps.
En dépit de nos alertes répétées sur la nécessité de développer des filières locales pérennes – notamment dans l’agriculture, le tourisme durable ou les énergies renouvelables – les Antilles françaises restent fortement dépendantes des importations et d’une économie de consommation subventionnée. Cette absence de vision stratégique a empêché la création de richesses productives endogènes, rendant les territoires particulièrement vulnérables aux chocs économiques et budgétaires.
L’inflation galopante et la hausse du coût de la vie également prévisible n’ont fait qu’amplifier ce phénomène, accentuant la précarité des ménages et fragilisant encore plus les finances publiques locales. Par ailleurs, la mauvaise gestion des collectivités locales a contribué à l’aggravation de la crise actuelle. Certaines communes et régions des Antilles accumulent depuis des années des déficits importants, résultant d’une gouvernance souvent marquée par le clientélisme, l’opacité budgétaire et un manque criant d’investissements productifs.
Trop souvent, les budgets ont été orientés vers des dépenses de fonctionnement au détriment de véritables politiques de développement économique et social. Cette mauvaise gestion a conduit à un endettement croissant, rendant aujourd’hui les collectivités incapables de faire face aux exigences de rigueur budgétaire imposées par l’État.
L’inaction face aux transformations démographiques et sociales constitue un autre élément d’explication du manque d’anticipation des élus. La population des Antilles vieillit, et l’exode des jeunes diplômés vers la métropole s’accélère, aggravant le déséquilibre économique local. Cette hémorragie de compétences réduit les perspectives de développement et limite la capacité d’innovation des territoires.
Pourtant, peu de mesures ont été mises en place pour inverser cette tendance ou pour attirer des investissements susceptibles de dynamiser le marché de l’emploi local. Enfin, il faut souligner la difficulté des élus à se projeter dans une vision à long terme face à des défis globaux comme le changement climatique.
La vulnérabilité des Antilles aux catastrophes naturelles et à la montée des eaux est bien documentée, mais les plans d’adaptation restent largement insuffisants. Or, une crise économique prolongée affaiblit encore plus la capacité d’investissement des collectivités pour préparer l’avenir. Ce manque d’anticipation risque d’avoir des conséquences désastreuses d’ici 2030, si des mesures d’urgence ne sont pas prises rapidement.
Ainsi, la crise actuelle en Guadeloupe et en Martinique n’est pas simplement le résultat des décisions budgétaires récentes de l’État. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de mauvaise anticipation politique, de gestion déficiente et d’absence de réformes structurelles. Loin d’être une fatalité, cette situation pourrait pourtant être corrigée par une refonte en profondeur des politiques publiques locales, en misant sur un développement plus autonome et une meilleure gestion des ressources.
Mais, pour cela, il faudra que les élus abandonnent les logiques d’attentisme et prennent enfin la mesure de l’urgence économique et sociale qui menace l’avenir des Antilles françaises.
Car loin d’être conjoncturelle, la situation actuelle révèle des failles structurelles profondes dans l’économie des Antilles françaises. La dépendance aux aides de l’État, combinée à un marché du travail souvent précaire et à un coût de la vie prohibitif, crée un environnement où la moindre pression économique se traduit par une crise sociale immédiate.
Les restrictions budgétaires imposées aux collectivités locales risquent d’amplifier ce phénomène en réduisant les capacités d’intervention des pouvoirs publics. Moins de subventions signifie moins de soutien aux entreprises locales et aux ménages en difficulté, renforçant un cercle vicieux de précarité et d’endettement.
Nous avons alerté régulièrement sur cette impasse financière, et recommandé à l’État un soutien adapté aux spécificités ultramarines en procédant à la réforme du modèle économique . Mais dans un contexte national marqué par des contraintes budgétaires strictes, les marges de manœuvre restent limitées.
Face à cette situation préoccupante, plusieurs pistes doivent être envisagées pour éviter un effondrement social et économique en Guadeloupe et plus largement en Martinique .
1. Un soutien renforcé aux collectivités locales : Pour éviter que les coupes budgétaires ne paralysent l’économie locale, une révision des dotations de l’État pourrait permettre de mieux prendre en compte les réalités ultramarines.
2. Des dispositifs de lutte contre le surendettement plus efficaces : Il devient urgent de renforcer l’accompagnement des ménages en difficulté, notamment en facilitant l’accès aux services bancaires et en promouvant des solutions de restructuration de dettes.
3. Un encadrement plus strict du coût de la vie : L’inflation et la cherté des produits de première nécessité pèsent lourdement sur les ménages antillais. Des mesures pour mieux encadrer les prix ou favoriser la production locale pourraient atténuer ces pressions.
4. Un développement économique repensé : Plutôt que de dépendre en grande partie des transferts de l’État, les Antilles françaises doivent explorer des modèles de développement plus autonomes, notamment via l’investissement dans les filières locales et le soutien à l’entrepreneuriat.
L’heure est donc à la mobilisation pour éviter une aggravation de la crise. Collectivités, entreprises et citoyens doivent, ensemble, trouver des solutions adaptées à cette situation d’urgence, sous peine de voir les difficultés s’enraciner durablement.
Economiste