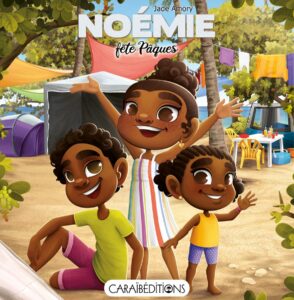L’historienne et spécialiste des relations franco-haïtienne, Gusti-Klara Gaillard a fait de nouvelles révélations au sujet de la dette imposée par la France à Haïti. Invitée à une conférence-débat organisée par l’ambassade d’Haïti en France, Mme Gaillard a indiqué que les méthodes de calculs des Français ont inclus dans les indemnités la valeur que représentait les anciens esclaves.
À l’approche de la commémoration du bicentenaire de l’indemnité que la France a imposée à Haïti qui a donné lieu à la double dette de l’indépendance, l’ambassade d’Haïti en France a organisé le mercredi 9 avril 2025 une conférence-débat en ses locaux. Réalisée autour du thème : « Haïti et l’ordonnance royale du 17 avril 1825 (1825-1922) », cette conférence-débat animée par la professeure Gusti-Klara Gaillard a rassemblé plusieurs ressortissants haïtiens vivant dans l’Hexagone.
Lors de son intervention, Gusti-Klara Gaillard a abordé plusieurs aspects de ce fait historique et a retracé avec force de détails la manière dont la France a fait payer à Haïti sa liberté acquise sur les champs de bataille deux décennies plus tôt.
L’un des aspects qui a retenu l’attention des participants, c’est quand l’intervenante a évoqué la manière dont la France a évalué les biens à indemniser dont les humains, qui étaient, au moment de l’esclavage, considérés comme « des biens meubles ». Mme Gaillard a souligné en effet, que dès 1825, en plus des plantations et des bâtiments, les commissions d’experts françaises ont intégré dans leurs calculs « les personnes qui ont été réduites en esclavage ».
La méthode d’évaluation prenait en compte la « valeur » des anciens esclaves, allant jusqu’à s’appuyer sur les anciens recensements coloniaux et les actes notariés où ces hommes, femmes et enfants figuraient comme des biens meubles, a révélé Gusti-Klara Gaillard. Si des dirigeants haïtiens se sont opposés à toute compensation pour les « pertes humaines », l’historienne a fait savoir que cette exigence a été intégrée à l’indemnité coloniale, au profit des anciens colons et de leurs créanciers.
Cette nouvelle révélation a provoqué des échanges instructifs entre l’intervenante et les participants. À noter que cette révélation de la professeure Gaillard arrive dans un contexte où en Haïti et en France, l’on s’apprête à commémorer le bicentenaire de la signature de l’ordonnance de Charles X et que côté haïtien depuis au moins de deux décennies, plusieurs voix ont réclamé « restitution et réparation ».
L’organisation de conférence-débat, selon le chargé d’Affaires a.i. d’Haïti en France, Louino Volcy « n’est pas un choix anodin ni isolé ». Elle s’inscrivait, selon le diplomate, dans le cadre des activités visant à commémorer le bicentenaire de la signature de l’ordonnance de 1825 et du bicentenaire de l’établissement des relations franco-haïtiennes.
« Les implications et les conséquences de l’ordonnance royale du 17 avril 1825 sont nombreuses et soulèvent des enjeux qui, au-delà de l’actualité liée à son bicentenaire, méritent d’être abordés et examinés sous un angle historique et scientifique afin d’éclairer le présent », a indiqué M. Volcy dans ses propos d’introduction.
Outre les ressortissants haïtiens établis sur le sol français, d’autres figures importantes du parlement français, des représentants du gouvernement français et ceux d’organisations internationales y ont également pris part.
La sénatrice de Saint-Barthélémy et vice-présidente du groupe d’amitié France-Caraïbes, Micheline Jacques; le député de la Guadeloupe, Christian Baptiste et le représentant régionale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour la Caraïbe et l’Amérique latine, Emmanuel Adjovi, sont parmi les personnalités qui ont participé à cette conférence.
Source : Le Nouvelliste