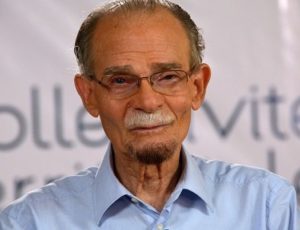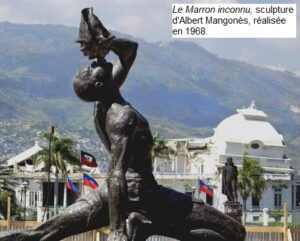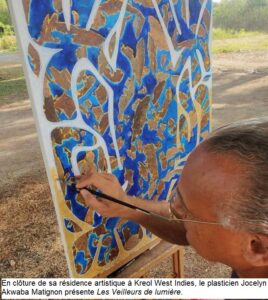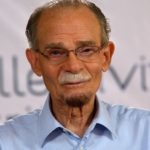Alors que les échanges franco-dominicains se renforcent à travers une présence économique diversifiée, Haïti reste un partenaire marginal, malgré son potentiel en matières premières.
En 2024, les échanges commerciaux entre la France et Haïti se sont établis à 54.9 millions d’euros (M€), en recul de 9,1 % par rapport à 2023. Cette baisse s’explique principalement par la contraction des exportations françaises (-11,5 %) vers Haïti. De l’autre côté de la frontière, la République Dominicaine affiche un volume d’échange de 379 M€ avec la France, soit près de sept fois plus. Un contraste d’autant plus frappant que les deux pays partagent l’île d’Hispaniola.
La balance commerciale entre la France et Haïti demeure structurellement excédentaire pour l’Hexagone, comme pour tous les pays partenaires commerciaux du pays, avec 16,6 M€ de solde positif en 2024. Cet excédent explique clairement une relation déséquilibrée entre les deux pays, où la France exporte bien plus à Haïti qu’elle n’en importe, sans réelle perspective de montée en gamme pour les exportations haïtiennes.
Haïti : une relation commerciale
fondée sur la dépendance
Les importations haïtiennes depuis la France sont dominées par des produits finis à usage immédiat : textiles usagés, machines industrielles, produits agroalimentaires transformés, équipements électriques. En 2023, selon les données douanières, les cinq principaux produits importés représentaient plus de 60 % de la valeur totale, confirmant une dépendance à des biens de consommation courante ou de seconde main.
En retour, les exportations haïtiennes vers la France sont peu diversifiées et fortement concentrées sur un seul produit : les huiles essentielles, notamment le vétiver, utilisé dans la parfumerie de luxe. En 2023, ce secteur représentait 82,6 % des exportations haïtiennes vers la France, pour une valeur de 14,6 M USD. Le reste – cacao brut, rhum, vêtements tricotés – est marginal.
République Dominicaine : un partenaire
régional stratégique pour la France
La République Dominicaine, quatrième partenaire commercial de la France dans la zone Caraïbes, incarne l’autre face de la stratégie française dans la région. Avec 207,4 M€ d’exportations françaises en 2024 (+11,2 %), elle s’impose comme une destination prioritaire des biens français : agroalimentaire (67,7 M€), machines (30,2 M€), cosmétiques, produits chimiques et industriels.
L’équilibre des flux commerciaux est notable : la France importe pour 171,8 M€ de biens dominicains, principalement agricoles (bananes bio, plantes médicinales, racines tropicales), mais aussi manufacturés (textiles, articles divers). La diversification des échanges et l’ancrage d’une classe moyenne urbaine consommatrice en République Dominicaine favorisent ce partenariat.
Un fossé d’investissement direct : 3 entreprises françaises
en Haïti, des dizaines chez sa voisine
Mais c’est du côté des investissements directs étrangers (IDE) que l’écart devient plus criant. En Haïti, seules trois entreprises françaises sont actuellement actives en 2025, opérant principalement dans la logistique, l’énergie ou les services. Elles évoluent dans un contexte de risque élevé : instabilité politique, crise sécuritaire et fragilité institutionnelle.
À l’opposé, la République Dominicaine accueille plusieurs dizaines d’entreprises françaises, avec des projets structurants dans :
- la mobilité urbaine (infrastructures de transport)
- l’agro-industrie et la transformation alimentaire
- les énergies renouvelables et la distribution
- les cosmétiques et produits pharmaceutiques
Cette présence sectorielle diversifiée traduit une confiance accrue des investisseurs français, stimulée par un environnement économique et politique relativement stable et une croissance soutenue du PIB (+5 % en 2024).
Pourquoi Haïti reste à l’écart ?
La faible attractivité d’Haïti en investissements directs étrangers (IDE) est d’abord liée à un climat des affaires dissuasif : insécurité chronique, faiblesse institutionnelle, absence de mécanismes juridiques fiables pour protéger les investisseurs, et infrastructures délabrées. Le niveau de risque pays perçu par les agences internationales reste parmi les plus élevés du continent. Les rapports ‘’Doing business’’ de la Banque mondiale et sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondiale (WEF) le confirment.
Cependant, cette lecture ne doit pas occulter les potentialités structurelles considérables du territoire haïtien. Haïti dispose de matières premières rares, à l’image du vétiver, ingrédient-clé des parfums français les plus prestigieux ainsi que d’une biodiversité agricole exceptionnelle, encore largement sous-exploitée. Le secteur agricole, bien que majoritairement informel, pourrait devenir un véritable moteur de développement, à condition d’être structuré autour de chaînes de valeur locales et d’une politique de transformation agro-industrielle.
Le secteur énergétique, quant à lui, reste un levier inexploré : Haïti bénéficie d’un fort potentiel hydroélectrique, solaire et éolien, mais n’attire que très peu d’investissements dans les énergies renouvelables. Pourtant, des initiatives régionales, notamment dans le sud et le nord du pays, pourraient émerger, si elles étaient accompagnées par des partenariats public-privé et des financements mixtes.
Sur le plan industriel, quelques zones franches existent, notamment autour de l’assemblage textile et de la sous-traitance, mais leur retour sur l’économie réel reste limité. Le tissu industriel haïtien souffre d’un manque d’intégration verticale, d’une faible productivité et d’un accès irrégulier à l’énergie et aux matières premières.
Enfin ,la question sécuritaire, souvent présentée comme un blocage général, mérite d’être relativisée géographiquement. Si Port-au-Prince reste effectivement le centre névralgique des tensions, avec une violence urbaine persistante et paralysante, de nombreuses villes de province – du Grand Sud à l’Artibonite, en passant par les régions frontalières du Nord-Est ou du Centre – bénéficient depuis plusieurs années d’un climat relativement stable, propice à des investissements ciblés.
Ces territoires, bien que souvent négligés par les stratégies nationales et internationales, représentent une réserve de croissance inexploitée. Un soutien ciblé, dans des secteurs tels que l’agrotransformation, l’artisanat, l’énergie ou l’écotourisme, pourrait générer un développement local inclusif, tout en déconcentrant la pression économique et démographique sur la capitale.
Quelles perspectives pour un rééquilibrage ?
La France gagnerait à réévaluer sa stratégie de présence en Haïti. Une politique économique plus ambitieuse pourrait s’appuyer sur :
- Un soutien ciblé aux PME exportatrices haïtiennes, notamment dans les secteurs cosmétiques, agroalimentaires ou artisanaux.
- La mise en place de partenariats techniques, via des organismes mixtes franco-haïtiens, pour développer la transformation locale.
- L’ouverture de zones franches durables, sécurisées, facilitant l’installation d’entreprises à capitaux mixtes.
Dans cette logique, l’enjeu est double : préserver une relation historique, tout en l’inscrivant dans les chaînes de valeur modernes. Une meilleure coordination entre diplomatie économique française, acteurs privés et société civile haïtienne est essentielle.
Une relation à repenser
Haïti et la France partagent une histoire, une langue, et une culture. Mais, sur le terrain économique, la relation peine à se traduire par un partenariat mutuellement profitable. Face à une voisine dominicaine qui capte massivement les IDE français, Haïti reste reléguée à un rôle marginal d’exportateur de matières premières brutes.
Un changement est possible. Il passe par l’amélioration du climat des affaires, la valorisation des ressources haïtiennes, et surtout par une volonté politique partagée d’inscrire Haïti dans une nouvelle trajectoire de développement économique, au cœur d’un partenariat stratégique rénové avec la France.
Il faudrait montrer que cette concentration existe en dépit de l’existence de l’APE qui offre des opportunités énormes au marché européen qu’Haïti n’a pas su exploiter.