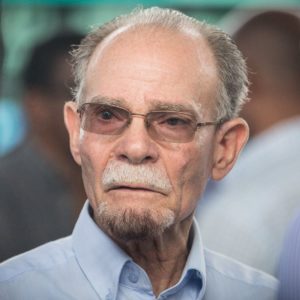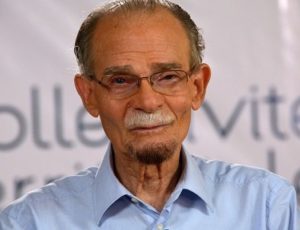A chaque sortie en mer qui leur permet de contrôler les navires de pêche venant des Etats voisins (Brésil, Guyana, Surinam), les forces de l’ordre constatent qu’ils recèlent des vessies natatoires, en quantité. C’est d’un véritable trafic dont il s’agit.
La marine nationale, les douaniers et les gendarmes procèdent, quasi chaque semaine, à la saisie de navires de pêche en situation illégale dans les eaux territoriales de la Guyane.
Sur ces navires, outre du poisson, dont le fameux acoupa, ils découvrent presqu’à coup sûr des vessies natatoires.
De quoi s’agit-il ? D’une poche que les poissons gonflent d’air pour se déplacer de bas en haut et de haut en bas. Cette poche, translucide, si elle n’était pas consommée jusqu’à il y a peu en Guyane, peut atteindre, sur le marché chinois, 2 000 euros le kilogramme.
Les marins-pêcheurs de Guyane les vendent entre 300 et 400 euros le kilo.
Pourquoi faire ? Comme la corne de rhinocéros ou d’autres substances d’animaux en voie de disparition, la vessie natatoire serait aphrodisiaque, et c’est pourquoi les Chinois l’apprécient. Séchée, réduite en poudre, la vessie est mélangée à des préparations culinaires, de la bière ou des produits cosmétiques.
Pour avoir un kilogramme de vessie natatoire, il faut ouvrir des dizaines, voire de centaines de poissons. Dont des acoupas, appréciés des Guyanais pour sa chair délicate.
Or, une fois la vessie natatoire récupérée sur les poissons, les pêcheurs illégaux jettent le poisson mort à l’eau. Il n’est pas vendu sur le marché.
Les autorités de Guyane ont constaté, alertés par les marins-pêcheurs, qu’il y avait de moins en moins d’acoupas au retour de pêche.
Cependant, les contrôles effectués sur des bateaux de pêche illégaux montrent que, depuis quelques temps, les saisies de vessies natatoires sont moins importantes.
En fait, les illégaux s’entendent entre eux. Un bateau fait le tour des navires de pêche, récupère les vessies natatoires collectées et les transporte rapidement vers le Surinam, le Guyane ou le Brésil. Le mal est fait.
Le chiffre d’affaires de ce trafic de vessies natatoires est estimé à plus de 300 millions d’euros chaque année.