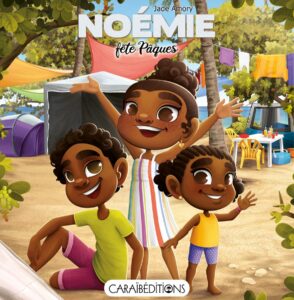Les sargasses envahissent les côtes au vent des îles de la Caraïbe, mais aussi celles du Mexique et du sud des Etats-Unis. SARGCOOP I et aujourd’hui II est un programme mis en place dans le cadre d’INTERREG CARAÏBES par l’Union Européenne.
Du 26 au 28 mars, la Région Guadeloupe organise la Séquence Internationale des Sargasses (SIS) à la Créole Beach Hôtel du Gosier.
Depuis quinze ans les algues sargasses — qui se cantonnaient auparavant au nord-est des îles de la Caraïbe, en un seul site appelé la mer des sargasses — se promènent sur l’océan Atlantique, émergeant au large des grands fleuves d’Amazonie et d’Afrique de l’Ouest au niveau de l’équateur pour remonter en tapis épais et étendu vers les îles des Caraïbes et les côtes de la mer des Caraïbes.
Ces algues, que l’on voit parfaitement depuis les satellites, s’échouent sur les côtes occasionnant asphyxie des fonds marins, pollution des plages, dégagement de gaz toxiques et diverses nuisances aux riverains.
Depuis quinze ans, mais plus particulièrement en 2018, 2023 et sans doute cette année selon les prévisions des experts, ces algues envahissent massivement les côtes et l’on ne sait qu’en faire. Alors, pêchées avant leur arrivée sur la côte, ou alors ramassées à coups de peletteuses sur les plages, ces algues sont stockées sur des sites dédiés ou, comme à Saint-Martin, faute de place, jetées à la décharge.
Ces algues, qui contiennent des métaux lourds et de l’arsenic quand elles se décomposent, sont une véritable pollution des sols et des sous-sols par infiltration des liquides de décomposition. C’est une nuisance pour les personnes sensibles comme les asthmatiques mais c’est aussi un danger pour les nappes phréatiques.


Les différents intervenants de la SIS réunis à la Créole Beach Hôtel ont repris les mêmes propos pour se plaindre de la situation. Surtout que des fonds sont consacrés chaque année au ramassage, en mer et à terre, puis au transport et au stockage. Car, il faut nettoyer pour éviter les nuisances aux habitants des îles de la Caraïbe mais aussi aux visiteurs, touristes qui font, pour certains Etats, l’essentiel des revenus du pays.
Des plages souillées par des algues, en y rajoutant l’odeur pestilentielle de ces végétaux pourrissants et les gaz toxiques qui s’en dégagent n’incitent pas le touriste à revenir.
Premier intervenant, la puissance invitante, Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe. Il y a, au premier rang, Ramon Lopez-Sanchez, responsable des relations internationales de la Commission Européennes (DG REGIO), Ferdy Louisy, vice-président du Conseil départemental de la Guadeloupe, Bernadette Davis, vice-présidente de la Collectivité de Saint-Martin, Jose Ramon Reyes-Lopez, vice-ministre des zones côtières et maritimes de la République dominicaine, Jean-François Moniotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre et la Grande-Terre. Dans cet ordre, chacun, plus quelques autres en visioconférence, vont intervenir.
Ary Chalus a rappelé son souci, depuis la conférence internationale organisée en Guadeloupe, par la Région, de mettre en place, avec l’Etat, les autres collectivités en Guadeloupe, avec les Etats de la Caraïbe, des actions, une mise en commun des connaissances, et préparer des actions toujours plus concertées face à cet envahissement des sargasses.
« C’est tout le bassin caribéen qui est concerné, pour la mise en œuvre des solutions transitoires et partager les connaissances et réfléchir à la valorisation de ces sargasses. Avec l’Organisation des Etats de la Caraïbe Sud (OECS), l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC), la Commission économique Atlantique et caraïbe de l’ONU, la DG REGIO, la délégation de l’Union Européenne à la Barbade, nous agisssons, démontrons le volontarisme de la Région Guadeloupe. »
« 17 ans que ça dure, déplore Ary Chalus, il est temps que nous trouvions des solutions. »
Ary Chalus :
Deuxième intervenant, Ramon Lopez-Sanchez, responsable des relations internationales de la Commission Européennes (DG REGIO), a mis en évidence « le travail de pionnier » de la Région Guadeloupe.
« Il faut, a-t-il dit, capitaliser sur ce qu’on a déjà obtenu. C’est un problème complexe, que ces échouements de sargasses, qui mérite un effort collectif. Il faut trouver des solutions pratiques et efficaces pour traiter ces échouements qui sont aujourd’hui des nuisances et qui peuvent être demain des opportunités économiques. Pour cela, il nous faut le soutien de partenaires du public et du privé. »
Complétant sa pensée, Ramon Lopez-Sanchez a lancé : « Il nous revient de mutualiser nos forces. Cette session en Guadeloupe est une opportunité de faire valoir nos expériences, d’échanger nos connaissances. Il nous faut identifier des pistes de valorisation de ces algues sargasses qui peuvent constituer une chance d’innovation. »
Christopher Corbin, coordinateur du secrétariat de la Convention de Carthagène, était en visioconférence. Qu’a-t-il dit ? Il a insisté sur l’impact sur la santé des plus fragiles et sur l’activité de pêche et de tourisme de ces afflux de sargasses dans la mer Caraïbe.
« Que faire ?, a-t-il dit. Valoriser ces sargasses. Des recherches sont en cours dans plusieurs pays, avec des équipes scientifiques éprouvées. C’est un problème qui concerne non seulement la Caraïbe mais aussi les côtes africaines et le sud des Etats-Unis et le Mexique. »
Bernadette Davis est vice-présidente de Saint-Martin. Collectivité d’Outre-mer, territoire de petite taille qui subit les assauts des algues sargasses. « Quatre plages sont impactées par ces échouements dont celle de Cul-de-sac est la plus touchée. Chaque année, voire plusieurs fois par an, les algues déferlent sur nos côtes. Or, nous sommes un territoire qui vit essentiellement du tourisme. Cela nous porte un lourd préjudice. Que faire de ces algues ? Nous les déposons à la décharge parce que nous n’avons pas beaucoup de place. Vivement qu’on trouve le moyen de valoriser ces sargasses. En deux ans, nous avons multiplié par trois le budget consacré à ce problème. C’est intenable. Il faut nous aider ! »
Bernadette Davis :
Ferdy Louisy, vice-président du Conseil départemental, remplaçait Guy Losbar, empêché.
Il a rappelé les engagements du Département et des autres collectivités de Guadeloupe, avec pour chef de file la Région, pour limiter l’impact des échouements sur les côtes, car ces dépôts d’algues sur les plages ont des conséquences néfastes pour l’économie, notamment touristique, pour la santé, pour l’environnement.
« Depuis 2011, 14 communes sont affectées dans l’archipel Guadeloupe, soit 73 kilomètres de littoral, 23 600 bâtiments habités. Ces sargasses en décomposition présentent des risques pour la santé des populations, dont les plus faibles, bébés, asthmatiques, personnes âgées, ont un impact négatif sur les activités touristiques et de pêche, mais aussi sur l’environnement. Les algues, en se déposant sur les fonds marins, détruisent les coraux, asphyxient les organismes marins et la faune marine. Il nous faut anticiper et suivre les arrivées et les échouements. En Martinique, 70 kilomètres de côtes sont impactés. Ici et là, il nous faut collecter, mais cela ne suffit pas. Il faut stocker puisqu’on ne sait pas encore valoriser, d’où des risques de contamination. »
Ferdy Louisy se réjouit cependant. « Nous avançons dans la recherche. On parle de charbon bio, de matériaux de construction, de biométhane. Ce sera long, sans doute, mais nous y allons ! »
Ulises Jauregui, coordonnateur du programme du doctorat en sciences environnementales de l’Institut Technologique de Santo Domingo (INTEC), mène des recherches pour valoriser les algues sargasses.
Ulises Jauregui :
Rudy Laplace est vice-président de la Collectivité de Saint-Barthélemy. Il remplace Xavier Lédée, président, empêché.
Que dit-il ? Que la collectivité a dépensé 1,4 million d’euros en 2024 pour le ramassage des sargasses sur les plages et que les échouements contribuent au recul du trait de côte, ce qui est dramatique pour une île aussi petite.
Cependant, plusieurs solutions sont cherchées pour valoriser les sargasses : la méthanisation, en mélangeant des algues, des graisses et des déchets alimentaires.
« Ces algues pourraient être des ressources abondantes et durables », affirme-t-il.
La valorisation pourrait être aussi en transformant les algues en charbon bio. « C’est utile en agriculture puisque le charbon bio est un capteur de pollutions des sols. Nous allons mettre en place prochainement un projet pilote. Cependant, il faut faire attention car ces algues contiennent des métaux lourds… »
Didacus Jules est directeur général de l’OECS. En visioconférence, ce politique explique : « C’est un devoir pour les générations futures de trouver des solutions communes au problème des sargasses. Il faut rechercher les potentiels développements de la valorisation des sargasses qui pourraient être, par captation du gaz naturel, un facteur d’autonomie énergétiques pour nos îles. Le temps de l’action c’est maintenant ! »
Autre intervenante, Noémi Espinoza Madrid, secrétaire général de l’AEC qui rappelle que ces sargasses sont « une urgence climatique », « une priorité régionale. »
« Nous ne devons pas affronter seuls ce défi ! »
Derniers intervenants, Jose Ramon Reyes-Lopez, vice-ministre des zones côtières et maritimes de la République dominicaine, et Jean-François Moniotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre et la Grande-Terre.
Jose Ramon Reyes-Lopez : « Les sargasses ne connaissent pas de frontières. C’est pour cela qu’il faut, entre nous, un dialogue France et déterminé. La République dominicaine travaille depuis de longues années sur ce problème des sargasses avec tous les acteurs concernés. Nous sommes devant un défi économique, de santé et environnemental. »
Jean-François Moniotte : « La coopération caraïbe est fondamentale. Nous avons, au niveau de l’Etat, à la sous-préfecture, une cellule PULSAR avec deux ingénieurs pour travailler avec la Région, le Département, les agences qui sont impliquées dans la recherche. Il nous faut comprendre les origines de ces sargasses, savoir comment éviter leur arrivée sur nos côtes, notamment grâce aux barrages dérivants, penser à leur valorisation qui passe par la collecte en mer et le stockage sur des sites sécurisés. Nous allons mettre en place rapidement un site pilote pour la valorisation de ces sargasses. »
« l’Etat a dépensé depuis 2021 16 millions d’euros pour traiter les échouages des sargasses sur l’archipel. »
Jean-François Moniotte :
Elle n’est pas intervenue mais elle est omniprésente sur ces trois journées du SIS. Sylvie Gustave dit Duflo est présidente de l’Office Français de la Biodiversité. Avec ses collègues scientifiques et techniciens, elle est à la pointe des connaissances sur le sujet des sargasses.
Sylvie Gustave dit Duflo :
Gaël Many est océanologue de Mercator Ocean.
Mercator Ocean International (MOi) est une organisation intergouvernementale, fournissant des services d’intérêt général basés sur l’océanographie et axés sur la conservation et l’utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines.
L’organisation a développé des systèmes complexes de simulation de l’océan (modèles numériques) basés sur des données d’observation de l’océan (satellite et in situ) qui sont capables de décrire, analyser et prévoir l’état physique et biogéochimique de l’océan à tout moment, en surface ou en profondeur, à l’échelle globale ou pour une zone spécifique, en temps réel ou en différé.
Mercator Ocean est indispensable pour surveiller les arrivées des sargasses en zone Caraïbe.
Gaël Many :
André-Jean VIDAL
aj.vidal@karibinfo.com