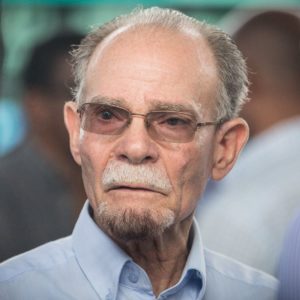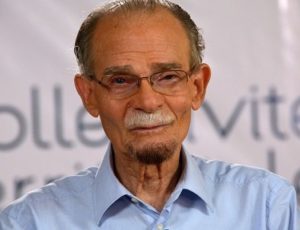Depuis février 2021, la Stratégie Chlordécone a été mise en place. Régulièrement, des comités de pilotage (COPIL) se tiennent en Guadeloupe et Martinique pour faire le point.


La chlordécone est une molécule qui a été répandue sur les champs de bananiers pendant vingt ans, quoiqu’on ait su rapidement qu’elle pouvait être dangereuse pour l’homme. Cependant, les producteurs de bananes, soutenus par les élus locaux qui sont allés plaider leur dossier à Paris auprès des gouvernements successifs de toutes tendance qu’ils soient, ont obtenu des dérogations pour l’utilisation de cette molécule. Aujourd’hui, ces derniers sont ceux qui crient le plus fort au scandale.
Jusqu’aux premières plaintes déposées par des associations.
Depuis, si le dossier judiciaire se traîne d’instance en instance, avec des non-lieux et des recours, il est un autre dossier, pris en mains par l’Etat, pour tenter de réparer le mal qui a été fait. Et celui-ci avance.
La Stratégie Chlordécone, qui vise le long-terme – la molécule est quasiment indestructible dans la nature et on ne sait pas comment l’éliminer malgré les recherches en cours — comprend 40 mesures.
Il s’agit d’informer les citoyens des régions concernées — Guadeloupe et Martinique — sur les risques, de protéger la santé des habitants et de réparer les préjudices liés à la contamination.
« Ce plan global et ambitieux, construit avec et pour tous, concrétise la reconnaissance de la part de responsabilité de l’État dans le scandale environnemental de la chlordécone », disent les autorités.
Pour mettre en œuvre les mesures, il faut des moyens : le budget consacré à la Stratégie Chlordécone était de 92 millions d’euros entre 2021 et 2027. Il a été porté à 130 millions sur la même période en 2023.
Il s’agit de renforcer le travail de recherche autour de la santé des femmes et des moyens d’accélérer la dégradation de la molécule dans la nature, à savoir les champs et anciens champs de bananiers, les terres se trouvant en aval de ces champs, et les cours d’eau, la mer à l’embouchure de ceux-ci.
Un COPIL s’est tenu à l’Université des Antilles (Guadeloupe), lundi 28 avril, présidé par Théo Gal, sous-préfet, chargé de mission eau, environnement, ruralités, et Edwige Duclay, directrice de projet, chargée de coordination du plan Chlordécone IV à la direction générale de la Santé.
Dans l’amphithéâtre, des élus, des chefs de services de l’Etat, des représentants d’associations.
Un débat s’est instauré, pour dire les attentes des associations, les inquiétudes des élus, les actions des chefs de services de l’Etat.
Que faut-il en retenir ?
Edwige Duclay, chargée de coordination du plan Chlordécone IV :
Ce qu’il faut intégrer c’est que l’on peut, sans se couper d’une alimentation locale, prendre des précautions : plus de 210 professionnels de santé dont 134 sages-femmes et gynécologues ont été formés et sensibilisés.
Fin mars 2025, plus de 8 578 dosagesont été réalisés avec une tendance nette à l’augmentation depuis 2021 et plus de 1 573 personnes avaient intégré un parcours d’accompagnement personnalisé déployé par l’Agence Régionale de Santé.
Sur simple demande, les champs peuvent être analysés, tout comme les fruits et légumes, les volailles, les œufs, les bovins, caprins, etc. qui auraient occupé le terrain suspect (ou pas). 1 430 analyses ont été effectuées depuis 2021 en Guadeloupe.
De même l’eau peut être analysée. Des prises de sang sur les plus de 18 ans réalisées pour détecter la présence de chlordécone dans le sang. C’est gratuit.
Les femmes enceintes peuvent être accompagnées.
Dr Florelle Bradamantis, directrice générale adjointe de l’ARS Guadeloupe :
Pour sensibiliser la population, plus de 500 éco-déléguéset plusieurs centaines de professeurs ont été formés depuis 2021, en Guadeloupe et en Martinique.
Pour ce qui est des professionnels de l’agriculture, 32% des sols suspects ont été analysés, 18 éleveurs ont été accompagnés, par Sanigwa, Depuis le 1er janvier 2024, les éleveurs de bovins bénéficient d’une aide financière de 160 à 200 euros par animal abattu. Depuis le 1er janvier 2024, 64 dossiers ont été déposés.
Pour ce qui est des professionnels de la pêche, une aide financière est en place depuis 2022.
Les travailleurs agricoles, de même, sont pris en charge par le Centre Régional de Pathologies Professionnelles et Environnementales (CRPPE) qui recommande, oriente, assure un suivi médical.
Il est possible aussi, une fois diagnostiqué, de bénéficier d’une indemnisation si l’on est victime de pesticides.
Au 5 mars 2025, en Guadeloupe, sur 102 dossiers complets reçus, 75 accords ont été prononcés et 60 indemnisations ont été versées sous forme d’une rente à vie pour les travailleurs ou exploitants et d’un capital pour les enfants. Les victimes peuvent bénéficier gratuitement de l’aide de l’association Phyto-victimes dans leurs démarches.
Enfin, les recherches sont engagées dans de nombreux domaines : la dépollution des sols, l’impact de la chlordécone sur la santé des femmes, des enfants et des travailleurs agricoles ou sur certains cancers.
Le budget initial de 26 M€ a été doublé à horizon 2030, soit 40 % du budget total. L’effort sur la recherche et l’innovation est doublé à horizon 2030, dans tous les domaines, notamment sur la santé des femmes et des enfants, la dépollution des sols et l’expérimentation en grandeur nature des découvertes des chercheurs.
En 2022, un appel à projets dédié à la chlordécone a été lancé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), en partenariat avec la région Guadeloupe et la Collectivité Territoriale de Martinique, avec une enveloppe de 5,5 M€ dont 4,5 M€ de l’ANR.
Cependant, il convient, ce qu’a rappelé Théo Gal, d’informer la population qu’il est risqué d’acheter des fruits et légumes sur des marchés informels – la question du marché de Gourde-Liane a été posée dans le public — de bord de route, tout comme il est risqué de consommer les œufs frais sortis de sous la poule qui picore dans un champ de bananiers ou de consommer la viande d’un bœuf abattu dans un champ et découpée sur un étal de fortune sous un manguier, comme on le voit tous les samedi matins, tôt, dans les Grands Fonds ou ailleurs à la campagne, souvent en bord de départementale pour que les clients puissent garer leur véhicule pas loin.
C’est pour cela que la traçabilité de ce que nous consommons est essentielle.
Théo Gal, sous-préfet chargé de mission eau, environnement, ruralités :
Prochain COPIL en novembre.
André-Jean VIDAL
aj.vidal@karibinfo.com