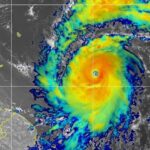Benjamin Stora et Karine Sitcharn, historiens, ont ouvert une série de travaux consacrés à un thème original : la Guerre d’Algérie et la perception qu’en ont eu les conscrits antillais.

Benjamin Stora, historien spécialisé par l’Algérie, de la colonisation à l’indépendance, est l’invité de prestige de ce colloque qui accueillera des spécialistes et des néophytes.
Mercredi 9 avril, ce sont des lycéens de terminale qui composaient le public de la séance d’ouverture dans la grande salle du MACTe, initiative du Département de la Guadeloupe en collaboration avec les organisateurs du colloque de la Faculté des sciences juridiques de l’Université des Antilles. Le colloque porte sur Mémoires et politisation : Regards croisés Algérie, France, Antilles.
Premier intervenant, Benjamin Stora, qui a planté le décor de la Guerre d’Algérie.
Benjamin Stora :
Pendant près d’une heure, l’historien va expliquer cette guerre qui, comme il l’a souligné, en France « a fracturé les partis : à gauche parce que c’était les socialistes et leurs alliés les communistes qui étaient au pouvoir au moment du déclenchement de cette guerre coloniale ; à droite parce qu’il y avait les partisans de l’Algérie française et les gaullistes. »
« La société française était au bord de la guerre civile », a-t-il commenté, faisant référence à l’OAS (Organisation Armée Secrète de du général Challes) et à la tentative de coup d’Etat d’un « quarteron de généraux en retraite » comme les a qualifiés de Gaulle.
« Le général de Gaulle l’a emporté avec des référendums. »
Pendant le temps de la Guerre d’Algérie, 1,5 millions de soldats du contingent ont été envoyés en Algérie, dans un pays dont ils ne connaissaient rien. « Ils ont passé, pour certains, jusqu’à trois ans là-bas, et en sont revenus profondément marqués. Quand ils sont revenus en France, la société avait changé, c’était dans les années 1960, le début de la société de consommation. Leur parole a été ensevelie. Toute une génération a été traumatisée par cette histoire », a souligné Benjamin Stora.
Autre traumatisme, celui de l’immigration algérienne « vers le pays qui leur faisait la guerre » qui a été multipliée par deux, tandis que le départ des Européens de &961 à 1970 a concerné un million de personnes dont les ancêtres étaient là depuis 1830.
Enfin, le massacre des harkis, en 1962, a concerné des milliers d’Algériens, supplétifs de l’armée française, victimes de tueries du Front de Libération Nationale (FLN).
Bilan de cette guerre : 400 000 morts côté algérien, 25 000 côté français, 2 millions de paysans algériens déplacés à l’intérieur de l’Algérie pour créer des zones interdites. Enfin, des affrontements internes de 1956 à 1962 entre membres du FLN et partisans d’une autre ligne, celle de Messali Hadj.
Cette guerre a été cruelle. « Petit à Petit, on découvre, affirme Benjamin Stora, que cette guerre a été très importante avec l’utilisation d’armes chimiques en 1959 avec le Plan Challes, avec aussi l’utilisation de napalm. »
Pourquoi une guerre aussi acharnée ? « L’Algérie, c’était trois départements français. On pouvait se séparer du Maroc, de la Tunisie, qui étaient des protectorats, mais pas d’une partie du territoire français. Toute l’histoire de la violence de cette guerre vient de là. Depuis la colonisation en 1830, il faudra 50 ans pour que la guerre cesse en Algérie. Jusqu’à 1958, les indigènes musulmans n’ont pas eu accès à la citoyenneté française réservée à la population européenne. Quand de Gaulle leur a donné la citoyenneté française en 1958 c’était trop tard. »
Seconde intervenante, introduite par Olivier Broutin, inspecteur d’académie : Karine Sitcharn, historienne, professeur en lycée et chargée de cours à l’Université.
Cette jeune femme a fait des travaux de recherche autour de la conscription aux Antilles françaises pendant la Guerre d’Algérie.
C’est le SS Colombie, un paquebot civil, qui emmène les conscrits antillais en France, au Havre. Un mois et demi plus tard, après avoir fait leurs classes, les jeunes militaires sont expédiés en Algérie. « Ils vont y connaître une guerre très violente. »
En fait, depuis 1912, les jeunes Antillais sont soumis au service militaire obligatoire. Ils ont connu deux Guerres mondiales. Environ 4 000 antillais ont fait la Seconde Guerre mondiale.
Deux types de recherches, des sources écrites dont le Fonds Foccard aux archives nationales et des sources orales (75 entretiens) ont permis de savoir combien de Guadeloupéens et de Martiniquais sont allés faire la guerre en Algérie.
« C’étaient des soldats du contingent ou des engagés. Pour les anciens combattants, la mémoire est toujours douloureuse. Certains ont dit qu’ils avaient l’impression d’avoir fait une sale guerre. »
Au début de la Guerre d’Algérie, ils sont 54 à partir. Ils sont beaucoup plus en 1959-1960. Pourquoi ? « Parce que pour certains le service militaire est assimilateur et évite l’explosion démographique. Guadeloupe et Martinique sont très peuplés et, si l’on prend la Martinique, plus encore que la Guadeloupe, les jeunes voient dans ce service militaire l’occasion de quitter une situation difficile. Il y a beaucoup de misère en Martinique. »
« Cette génération, disent les commentateurs, a été marquée par cette guerre. Or, révèle Karine Sitcharn, il n’y a pas de génération Algérie. 10% des recensés partent, 1 316 pour la Guadeloupe, 2 618 pour la Martinique. Il y a deux groupes : les étudiants en France, politisés, et les classes populaires qui veulent appartenir, par l’Armée, à la communauté nationale. Et quand on regarde le nombre de réfractaires : insoumis, déserteurs, etc. il y a 17 Martiniquais et 42 Guadeloupéens. Et les réfractaires ne sont pas les jeunes étudiants, qui savent bien qu’ils seront plus tard fonctionnaires, médecins, avocats, mais les jeunes des classes populaires. »
Le débat s’est poursuivi par des questions-réponses avec le public.
Le programme du colloque :
Jeudi 10 avril 2025 – 19 heures
Résidence départementale – Le Gosier
Soirée d’échange entre Christiane Taubira, ancienne Garde des Sceaux, rapporteuse de la loi reconnaissant l’esclavage comme crime contre l’Humanité et titulaire de la chaire José Bonifacio Sao Paulo, et des jeunes lycéens et étudiants guadeloupéens.
Vendredi 11 avril 2025 – 10 heures
Résidence départementale – Le Gosier
Inauguration de la phonothèque dédiée à la mémoire d’anciens combattants guadeloupéens de la guerre d’Algérie, parrainée par Benjamin Stora
Campus universitaire de Fouillole – Amphithéâtre Lepointe
16 h 30 – Conférences inaugurales du colloque :
« Mémoires et politisation : regards croisés Algérie, France, Antilles »
18 h 45 – Panel 1 : L’œuvre de mémoire : enjeux et stratégies en Guadeloupe, Algérie et dans la reconnaissance de l’esclavage
19 h 20 – Débat et clôture de la première journée
Samedi 12 avril 2025 – 8 à 13 heures
Campus universitaire de Fouillole – Amphithéâtre Lepointe
8 h 15 – 10 heures – Panel 2 : La relation à l’Algérie, un nœud mémoriel
Sous la présidence de Raymond Boutin, historien, président de la Société d’Histoire de la Guadeloupe
9 h 30 – Débat
10 h 15 – 13 heures – Panel 3 : Les Antilles, lieu de mémoires vives, entre guerre d’Algérie et mémoire de l’esclavage, sous la présidence du professeur Sébastien Mathouraparsad
13 heures – Débat et clôture du colloque