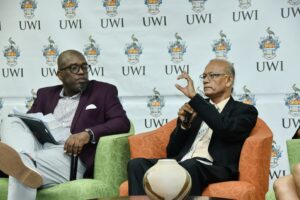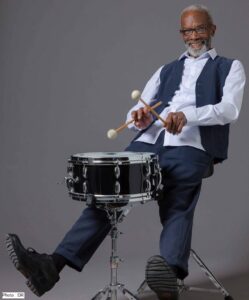Pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des stratégies du plan 2021-2027 contre le chlordécone aux Antilles, le Gouvernement a nommé une directrice de projet chargée de la coordination interministérielle du plan, Edwige Duclay. Mme Duclay est en Guadeloupe.
Edwige Duclay a fait le point sur les avancées sur un dossier qu’elle qualifie elle-même de « sensible » : le plan contre le chlordécone aux Antilles, Guadeloupe et Martinique.
Lancé en 2021 et courant jusqu’en 2027, ce plan se met en place petit à petit, avec plus de moyens depuis l’an dernier. Et aussi avec une stratégie renforcée, axée sur des partenariats essentiels : élus, personnels de santé, chercheurs, associations, médias.
Quatre ans après son lancement — et le début de la mission d’Edwige Duclay —, ce plan connaît, dit-elle, « un changement de braqué et d’ambition. »
Comment ? « Il s’agit, tout d’abord de travailler en toute transparence, avec tout le monde. Pour ce faire, des moyens ont été renforcés : nous sommes passés de 92 millions au départ à 130 millions, dont 36 millions ont été dépensés ces trois dernières années pour mettre en place différentes opérations. »
« Le fait qu’il y ait beaucoup de colère dans ce dossier a mis un frein aux mesures de protection », regrette-t-elle, détaillant ces mesures :
- Analyses de sang (elles sont gratuites, par des médecins en Guadeloupe)
- Communication sur le fait que les analyses de sang positives n’impliquent pas automatiquement que l’on soit malade : « Si l’on est positif au chlordécone, avec un taux de 0,4 microgrammes par litre de sang, on est appelé par une plateforme qui donne un rendez-vous pour en parler. »
Que se passe-t-il ensuite ? Il existe des ateliers pour expliquer qu’il faut prendre garde à sa nourriture, car c’est par la nourriture que l’on est contaminé. Qui dit nourriture dit aussi eau. On y reviendra.
Les personnes positives sont accompagnées. Fin 2023, il y avait plus de 23 000 personnes qui avaient procédé à une analyse sanguine, entre Guadeloupe et Martinique, dont un peu plus de 2 000 qui ont suivi le dispositif mis en place : accompagnement avec visite à la maison par une diététicienne, pour examiner les pratiques alimentaires : fruits et légumes, viande « du jardin ou sous le manguier » ou achetées dans le voisinage, échangés avec d’autres personnes, etc. Il faut éliminer toute source de contamination, donc analyser aussi l’eau consommée, les œufs des poules qui picorent dans le jardin ou la pelouse.
Les éleveurs reçoivent la visite de contrôleurs de la DDAFF, pour faire des prises de sang des animaux du troupeau, prélever de la terre pour analyse. En cas de contamination, il faudra changer les bêtes de parcelle ou les déplacer en zone saine.
« Tout ceci, bien sûr, ne se fait pas facilement : les gens ont peur de se faire dépister, les éleveurs ont peur de constater que leurs animaux sont contaminés. Mais, il en va de la santé des gens et des bêtes qui seront consommées par les gens. Car, la contamination n’est pas une situation permanente. La décontamination, si l’on coupe la source de contamination, est réelle. Et c’est pour cela qu’il faut se faire dépister très vite, pour éliminer la contamination et éviter que celle-ci se transforme en maladie plus tard », affirme Edwige Duclay.
Outre les adultes et les enfants (qui eux aussi doivent être dépistés, qu’ils soient enfants d’agriculteurs en contact avec le chlordécone ou pas), les femmes enceintes doivent être dépistées. Sur 4 000 naissances environ 600 femmes ont suivi le dispositif.
Que fait l’Etat ? Outre d’abonder des fonds pour le plan chlordécone annuel, il règle aux laboratoires le prix du dépistage, des gens et des bêtes, les analyses d’eau (en 2023, l’Etat a décidé de financer avec 1,13 millions d’euros en Guadeloupe et 800 000 euros en Martinique chaque année le surcoût eau potable pour l’achat des filtres) et de sols, le manque à gagner des marins-pêcheurs qui doivent sortir des zones maritimes chlordéconées pour exercer leur métier, le manque à gagner des éleveurs (les recherches diverses menées autour du chlordécone.
Les contrôles par les services de l’Etat concernent les produits alimentaires vendus, importés ou produits en Guadeloupe et Martinique, l’eau potable, les zones de pêche, les élevages et leurs aires, etc.
Autre souci d’Edwige Duclay, « l’amélioration des connaissances. L’aide aux efforts de recherches a été multipliée par deux. »
L’éducation, l’information, sont aussi importantes: « celle des élus, des professionnels de santé, des associations, etc. »
Edwige Duclay se félicite des bons offices de l’Association des maires de Martinique qui mettent en place des actions.
« L’eau est aussi une source de contamination aux pesticides, dont le chlordécone. Les tests réalisés en 2023 montrent que 99% des eaux potables sont conformes aux normes, 97% en 2024. L’habitude, surtout en Martinique, mais c’est aussi vrai en Guadeloupe, est d’aller remplir des nourrices et bouteilles aux sources dans la nature. Or, l’eau de source n’est pas une solution. Celles qui ont été contrôlées présentent des taux de contamination impressionnants. Il ne faut pas boire de ces eaux là », explique Edwide Duclay
« Les avancées, quoiqu’on en dise, sont là. Avec comme perspectives pour les années à venir de mieux faire connaître les dispositifs de dépistage et les mesures prises, de réduire l’exposition, de s’engager avec des partenaires, de travailler avec les associations de maires qui sont en prise directe avec les populations », conclut Edwige Duclay.