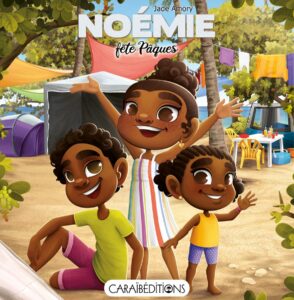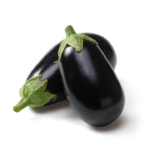PAR JEAN-MARIE NOL*
La diplomatie française connaît un tournant majeur qui suscite interrogations et débats. Longtemps attachée à la francophonie comme pilier de son influence internationale, Paris semble aujourd’hui réorienter sa stratégie vers de nouveaux horizons. Nous en voulons pour preuve l’analyse personnelle selon laquelle la France est en train de sacrifier l’aide au développement en Afrique francophone.
En effet, force est de constater que l’aide au développement perd un tiers de sa dotation . Un sérieux coup de rabot. L’aide publique au développement (APD), qui finance notamment les actions des ONG dans les pays du sud voit son budget amputé d’1,3 milliard d’euros. Déjà, en février dernier, lorsque Bercy cherchait à faire 10 milliards d’économie, 743 millions avaient été ponctionnés sur l’aide au développement….
Ainsi la loi de finances pour 2025 voté au parlement prévoit une nouvelle baisse drastique de l’enveloppe budgétaire consacrée à l’aide publique au développement (APD), qui regroupe des financements publics destinés aux pays pauvres et émergents notamment de l’Afrique francophone.
La France prévoit d’y consacrer 5,2 milliards d’euros, soit une réduction de plus de 20 % par rapport à l’année précédente (6,5 milliards d’euros).
Cette annonce, bien qu’attendue, suscite l’émoi au sein des associations d’aide aux plus démunis. L’APD joue un rôle primordial dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités, en finançant des programmes tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. D’autant que le budget consacré au programme « Solidarité à l’égard des pays en développement » prévoit une baisse encore plus importante : environ -33 % par rapport à l’année. précédente.
Concrètement, cette coupe de plus de 1,3 milliard dans le budget équivaut à la suppression de milliers de projets menés auprès des personnes vulnérables ou encore à la fin d’un accompagnement scolaire pour des millions d’enfants.
Ce virage diplomatique est profond et semble parti pour durer. Le nouveau désintérêt pour les anciennes colonies françaises et l’intérêt croissant pour les anciennes colonies britanniques en Afrique et le rapprochement avec l’Inde traduisent une volonté d’adaptation aux mutations géopolitiques, économiques et technologiques du monde contemporain.
Ce basculement ne signifie pas un abandon total des anciennes colonies françaises, mais plutôt une redéfinition des priorités et une diversification des alliances face aux nouvelles réalités du XXIe siècle. Car l’économie semble appelée à prendre de moins en moins de place en francophonie. L’Afrique francophone, autrefois perçue comme le pré carré de la diplomatie française, est aujourd’hui traversée par de profonds bouleversements.
L’influence de la France y recule sous l’effet de tensions croissantes, notamment au Sahel, où des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Tchad ont remis en question leur coopération militaire avec Paris.
Car le rejet n’est pas que militaire, il est aussi politique et économique. Au cœur des griefs contre la France, on trouve, entre autres, la critique d’un positionnement à géométrie variable vis-à-vis des régimes en place, l’image du franc CFA et à sa symbolique néocolonialiste, une politique d’aide au développement jugée paternaliste.
Le départ des troupes françaises du Mali, du Tchad et du Niger illustre cette perte de contrôle, alors que la Russie, via le groupe Wagner, et la Chine, par sa diplomatie financière et économique des nouvelles routes de la soie, gagnent du terrain.
Ces évolutions traduisent une montée du sentiment anti-français, nourri par des élites africaines et des mouvements panafricanistes, qui dénoncent l’ingérence de l’ancienne puissance coloniale et revendiquent une souveraineté accrue. La France est chassée de plusieurs pays de l’Afrique francophone et cette éviction signe l’échec d’une succession de politiques postcoloniales, y compris de celle qui entendait rompre avec l’anachronique « Françafrique ».
Face à cette hostilité grandissante, la France cherche à maintenir un ancrage sur le continent en développant des relations avec des pays africains anglophones comme le Kenya, le Ghana, le Nigeria, le Rwanda ou l’Afrique du Sud. Ces États, qui affichent une relative stabilité et un dynamisme économique certain, apparaissent comme des partenaires plus prometteurs, moins enclins à remettre en cause les fondements de leur coopération avec Paris.
Ce repositionnement stratégique vise à préserver une influence africaine tout en contournant les foyers de contestation les plus virulents.Outre ses intérêts stratégiques et politiques, la France a des intérêts économiques à préserver sur le continent africain.
Il apparaît impératif pour elle de rester parmi les partenaires commerciaux de premier plan face à d’autres Etats ambitieux, qui viennent non seulement commercer avec l’Afrique, mais aussi y prendre ancrage dans les domaines clés des services financiers, de l’énergie, des infrastructures, des télécoms, de l’agro‐industrie et du BTP.
Le volet culturel n’est pas en reste, dans la mesure où la francophonie constitue la cheville ouvrière du soft power français en Afrique. Ainsi, « 60% des francophones résident sur le continent africain, une donnée en hausse de 15% depuis 2018 », selon des chiffres attribués au Quai d’Orsay. « Une progression qui s’explique par la croissance démographique de la population africaine ». Or, la francophonie ne revêt plus une importance cruciale.
Ce ministère a même été supprimé dans les derniers gouvernements en France. Force est donc de constater que la Francophonie ne constitue malheureusement plus une véritable priorité pour la France. C’est manifeste au sein de l’organisation internationale de la francophonie (l’OIF ) .
Tous se souviennent de la célèbre déclaration d’Emmanuel Macron faite à Lyon en 2017 : « Il n’y a pas de culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse. » Des mots restés en travers de la gorge de nombreux artisans de la Francophonie.
Mais cela ne peut masquer le fait que la francophonie est aujourd’hui en panne de dessein politique. Elle n’a pas les moyens de déployer de stratégie dans les quatre domaines permettant de consolider la langue française : la science, la culture, l’économie et surtout l’éducation. En fait, nous assistons à une nouvelle stratégie géopolitique et une autre vision de la France dans la recherche de nouveaux partenariats avec les anciennes colonies anglophones et lusophones.
Dans cette quête de nouveaux alliés, l’Inde s’impose comme un partenaire stratégique incontournable, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Le pays est aujourd’hui une puissance émergente majeure, en pointe dans le développement de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des infrastructures numériques.
Face à la domination américaine et chinoise dans ces secteurs, la France voit en New Delhi un allié de choix pour diversifier ses coopérations technologiques et réduire sa dépendance aux grands pôles d’innovation. Le partenariat stratégique entre les deux pays s’est récemment renforcé, comme en témoigne l’invitation d’Emmanuel Macron en tant qu’invité d’honneur du Jour de la République en Inde en janvier 2024.
Ce rapprochement s’inscrit dans une vision plus large de la diplomatie française, qui cherche à tisser des alliances solides dans un monde multipolaire où les équilibres de pouvoir évoluent rapidement. L’Inde, avec sa croissance soutenue et son expertise technologique, représente un relais de puissance complémentaire aux ambitions françaises sur la scène internationale.
Dans ce contexte de réorientation diplomatique, le concept même de francophonie connaît une mutation. Longtemps perçue comme un instrument d’influence culturelle et politique, la francophonie tend aujourd’hui à s’émanciper d’une approche néocoloniale pour se recentrer sur des coopérations économiques et culturelles plus équilibrées. Cette évolution se traduit notamment par le cas du Rwanda, pays autrefois francophone qui s’est tourné vers l’anglais mais avec lequel Paris entretient désormais des relations renforcées.
Ce recentrage témoigne d’une volonté d’adaptation aux dynamiques contemporaines, où l’usage de la langue française ne peut plus être imposé comme un vecteur d’influence unique. En parallèle, la France tente de répondre aux critiques sur son passé colonial en ajustant son discours et en mettant l’accent sur une francophonie ouverte, déconnectée des rapports de domination hérités de l’histoire. Cette transition vise à rendre l’influence culturelle française plus attractive et moins controversée, tout en maintenant un lien avec les populations qui continuent de parler français à travers le monde.
Au-delà des considérations stratégiques et économiques, ce changement de cap s’explique aussi par une volonté d’anticiper les tensions mémorielles liées à la colonisation. En diversifiant ses alliances et en s’ouvrant à de nouveaux partenaires, la France cherche à désamorcer les critiques récurrentes sur son ingérence en Afrique et à éviter d’être perçue comme une puissance déclinante accrochée à son passé colonial.
Investir dans des relations avec des pays qui ne portent pas le même passif historique permet de solder, du moins partiellement, les contentieux du passé et d’ancrer la diplomatie française dans une dynamique plus tournée vers l’avenir. Ce recentrage ne signifie pas un désengagement total des anciennes colonies françaises, mais il marque une rupture avec les logiques traditionnelles de la Françafrique.
En privilégiant des États émergents et dynamiques, moins contestataires que certains pays africains francophones, Paris prépare l’après-Françafrique tout en cherchant à préserver ses intérêts économiques et géopolitiques dans un monde en mutation rapide.
Ce rééquilibrage des relations internationales traduit ainsi une double nécessité : celle de s’adapter à un environnement géopolitique de plus en plus complexe et celle de repenser la place de la France dans le concert des nations. En s’ouvrant à de nouveaux espaces de coopération, en misant sur des partenaires stratégiques comme l’Inde et les pays anglophones d’Afrique, Paris tente d’inscrire son influence dans une logique renouvelée, moins marquée par le poids du passé et plus en phase avec les enjeux du XXIe siècle.
Cette stratégie, qui repose sur une diversification plutôt qu’un abandon, pourrait permettre à la France de conserver une place de choix sur la scène internationale, à condition de réussir cette transition sans renier totalement ses alliances historiques.
*Economiste